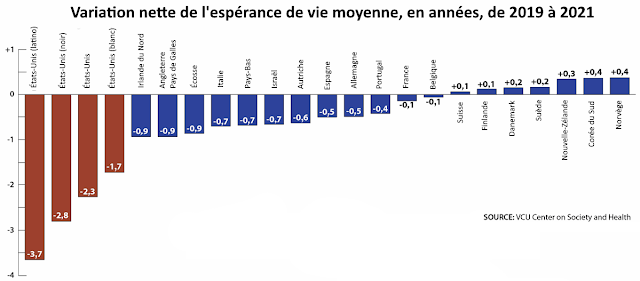Une adolescente ukrainienne scolarisée en France s’est étonnée du faible niveau en mathématiques de sa nouvelle classe.
Le rapport remis à Jean-Michel Blanquer le 21 mars sur « la place des mathématiques dans la voie générale du lycée » le reconnaît sans ambages :
« Le niveau moyen de compétences en mathématiques en France est en baisse depuis près de quarante ans », et ce « quel que soit l’outil d’évaluation mobilisé (Timss, Cedre, LEC ou Pisa) ».
.jpeg) |
Olivier Rey
|
Le Figaro. — Comment expliquez-vous cette baisse de niveau ?
Olivier Rey. — Dans son discours aux « acteurs du numérique », en septembre 2020, Emmanuel
Macron s’enchantait : « L’éducation, on a un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. (…)
Quelle autre économie au monde permet à des talents de former leurs enfants à l’école
publique avec une école de qualité exceptionnelle tout au long de leur vie ? La France. » Il y a
soixante ans, pareilles affirmations auraient été fondées. Aujourd’hui, on se demande ce qui
permet à la présidence de la République de tenir des propos que tout dément, de la simple
observation à l’ensemble des enquêtes, nationales ou internationales. Peut-être un rapport
Mckinsey serait-il nécessaire pour que l’information remonte jusqu’à l’Élysée ? Quelques
décennies de réformes ininterrompues, plus désastreuses les unes que les autres, ont accompli cette performance de ravaler « un des meilleurs systèmes éducatifs au monde » au rang de
système déglingué, que seul un certain nombre d’enseignants encore pénétrés de l’ancienne
dignité de leur tâche empêchent de s’effondrer tout à fait.
Dans ce sombre tableau, les mathématiques occupent une place à part. Un moment, en tant
que seule discipline sélective qui demeurât, les mathématiques ont résisté au naufrage. Mais
bientôt, cette résistance elle-même a paru insupportable : les horaires ont été rabotés, les
filières ont perdu de leur substance, les exigences ont baissé dramatiquement. Comme le relevaient d’éminents scientifiques : « Que dans l’état actuel des programmes, des professeurs parviennent néanmoins à initier leurs élèves aux mathématiques et que certains élèves continuent à travailler et à s’intéresser aux mathématiques et aux sciences est un miracle qui tient
à l’existence d’esprits particulièrement robustes et pugnaces, et aussi à l’aide des familles ou
de remédiations extérieures, mais un “miracle” qui s’accompagne d’une chute très importante du nombre des vocations, et dont nous ne savons pas combien de temps encore il perdurera si les conditions actuelles ne s’améliorent pas. » Selon les dernières enquêtes, la
France, naguère bastion de l’enseignement mathématique, occupe une place désastreuse, très
inférieure à la moyenne de l’Union européenne ou de L’OCDE. Au collège, par exemple, 2 %
des élèves sont crédités du niveau « avancé » en mathématiques, contre 11 % dans l’Union
européenne et 50 % à Singapour. Le Vietnam, dont le système scolaire est demeuré profondément marqué par ce que la France avait mis en place du temps de la colonisation, obtient
aujourd’hui, précisément parce qu’il est demeuré fidèle à cette empreinte, de bien meilleurs
scores que notre pays qui, par ses mirobolantes réformes prétendant assurer l’excellence
pour tous, ne cesse d’étendre le domaine de la médiocrité.
— Des initiatives n’ont-elles pas été prises pour remédier à cet état de fait ?
— En 2005, le président de la République Jacques Chirac a créé un Haut Conseil de l’éducation,
dont les préconisations devaient aider à redresser une situation déjà jugée alarmante. Parmi
les membres de ce conseil, le mathématicien Laurent Lafforgue, qui s’était vu décerner
quelques années auparavant la médaille Fields. Le conseil ayant décidé, pour mener ses travaux, de faire appel aux experts du ministère de l’Éducation nationale, Lafforgue a fait part,
dans un courrier privé adressé au président du conseil, Bruno Racine, de son désespoir : comment attendre le salut de ceux-là mêmes qui avaient conduit à une situation si dégradée ?
Racine diffusa ce courrier et demanda à Lafforgue de démissionner. Moyennant quoi les
experts en pédagogie ont continué leur œuvre : pour eux, la réponse aux échecs patents de
leurs réformes consiste à poursuivre et radicaliser celles-ci. Les forces à l’œuvre avaient été
parfaitement identifiées et décrites dès les années 1980 par le philosophe Jean-Cclaude Milner,
dans son livre De l’école. Depuis, le mouvement n’a fait que se prolonger et s’intensifier. Fiant
paedagogiae progressistae principia et pereat Gallica schola [1].
— Avec la réforme du baccalauréat en 2019, les mathématiques ont été purement et simplement
supprimées des enseignements dits communs, rendant caduc leur apprentissage obligatoire
en première (hors spécialité mathématique). Jean-Michel Blanquer a annoncé un retour aux
modalités antérieures. Était-ce une erreur stratégique de supprimer cet enseignement ?
— Simone Weil remarquait que, « bien qu’aujourd’hui on semble l’ignorer, la formation de la
vertu d’attention est le but véritable et presque l’unique intérêt des études. La plupart des
exercices scolaires ont aussi un intérêt intrinsèque ; mais cet intérêt est secondaire. Tous les
exercices qui font vraiment appel au pouvoir d’attention sont intéressants au même titre et
presque également ». Le premier objet d’attention à proposer aux enfants à l’école est la
langue avec laquelle nous nous exprimons. Être attentif aux mots que l’on emploie et à la syntaxe est au fondement de tout — y compris en mathématiques, où nombre de difficultés rencontrées par les élèves, à l’heure actuelle, tiennent tout simplement à une maîtrise insuffisante de la langue.
Au début du XIXe siècle, le père du jeune Augustin Louis Cauchy, constatant les dispositions
de son fils pour les mathématiques, alla demander conseil au grand géomètre Lagrange sur
l’éducation qu’il convenait de donner à l’enfant. Lagrange répondit : « Ne lui laissez pas ouvrir
un livre de mathématiques ni écrire un chiffre, avant qu’il ait achevé ses études littéraires. »
Le jeune Cauchy collectionna les prix en latin et en grec, avant de devenir un des plus brillants
mathématiciens de son temps. Aujourd’hui que l’enseignement des langues anciennes a
presque disparu, et n’a plus rien du niveau d’antan, le conseil de Lagrange est « obsolète ». Au
sein du marasme général, seules les mathématiques avaient réussi à conserver un minimum
de prestige et d’exigence. De ce fait, leur éviction des enseignements communs au lycée est un
renoncement supplémentaire.
— Vous avez vous-même fait Polytechnique, puis êtes devenu chercheur en mathématiques au
CNRS avant de vous tourner vers la philosophie. En quoi l’enseignement des mathématiques
est-il fondamental ?
— Comme je l’ai dit, je ne tiens pas l’enseignement des mathématiques comme le plus fondamental — la langue et la littérature viennent avant. Il y a des esprits bien formés et d’une
intelligence supérieure tout à fait fermés aux mathématiques. Encore faut-il que l’enseignement des humanités ressemble à quelque chose. Par ailleurs, nous vivons dans un monde
technologique. Je distingue les techniques, fruits directs de l’ingéniosité humaine, des technologies, inimaginables sans les sciences mathématiques de la nature qui ont pris leur essor
au XVIIe siècle, et ont changé la face du monde à partir du XIXe. Lors des journées portes
ouvertes à l’école polytechnique, des visiteurs du Centre de mathématiques posaient régulièrement la question : à quoi peuvent bien servir aujourd’hui les mathématiques ? La vérité,
c’est qu’elles servent à peu près à tout, impliquées qu’elles sont dans les théories physiques,
la modélisation, et « encapsulées » qu’elles se trouvent dans l’immense majorité des dispositifs et appareils que nous utilisons. Dans la mesure où les mathématiques sont au fondement
du monde dans lequel nous évoluons, elles sont bel et bien devenues un savoir fondamental.
— Selon l’organisation professionnelle de l’ingénierie, il manquerait près de 20 000 ingénieurs
diplômés en France par an. Peut-on faire un lien avec la baisse de niveau en mathématiques ?
Que cela vous inspire-t-il ?
L’ingénierie a à faire avec la technologie, liée aux sciences mathématiques de la nature, et
donc aux mathématiques. De ce fait, une baisse générale de niveau en mathématiques ne peut
qu’avoir des effets négatifs dans le domaine de l’ingénierie. Depuis des décennies, le souci
unique des réformes de l’enseignement est d’inclure tout le monde, hier jusqu’au lycée,
aujourd’hui jusqu’au bac, demain peut-être jusqu’au doctorat. L’alignement sur les élèves en
difficulté se justifie par le fait que les autres, « ils s’en sortiront toujours ». Ils s’en sortent
sans doute, mais à un niveau inférieur à celui qui aurait été le leur si leurs capacités avaient
été correctement cultivées. L’excellence pour tous proclamée, cela ne donne dans les faits
l’excellence pour personne.
Le manque en ingénieurs de bon niveau a une autre cause, qui tient au virage massif et revendiqué de l’économie française vers les services, au détriment de la production. Les écoles
d’ingénieurs en tirent les conséquences : de moins en moins écoles d’ingénieurs, de plus en
plus d’écoles de commerce, dont beaucoup des meilleurs élèves s’orientent vers la finance et le « conseil ».
— In fine, cela se traduit-il par une perte de savoir-faire et de souveraineté ?
— Oui. Lorsque la situation générale se tend, la dialectique du maître et de l’esclave de Hegel
revient sur le devant de la scène : que les « chaînes de valeur » se grippent, que la logistique
s’enraye, et ceux qui savent faire se retrouvent en bien meilleure position que ceux qui ne
savent plus que faire faire.
— Vous avez séjourné dans des universités chinoises. Avez-vous pu observer l’investissement de
la Chine dans l’enseignement des mathématiques ?
— À la fin du XIXe siècle, un lettré chinois écrivait ceci : « Les superbes inventions des pays occidentaux nous sont, pour la plupart, inconnues et nous semblent incroyables… Mais, mon
grand frère, peut-être allez-vous demander si toutes ces choses presque miraculeuses rendent
les hommes plus heureux ? C’est une question très difficile à résoudre. Je ne sais pas ! Tout ce
que je sais, c’est que ces machines travaillent cent fois plus vite que le manœuvre. Vous allez
me demander si la vitesse est un bonheur… Je ne sais pas. Je suis seulement persuadé que sans
ces inventions techniques et cette vitesse, on ne peut acquérir aucune puissance. Si on ne
l’atteint pas, on reste plongé dans l’humiliation. Si l’on veut pouvoir se défendre, il faut absolument être en possession de cette science matérielle. » En Chine, la période qui s’étend de la
première guerre de l’opium, en 1839, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est
nommée « siècle de l’humiliation ». Et c’est cette expérience qui nourrit la frénésie avec
laquelle la Chine s’est lancée depuis lors dans la course technologique.
Les Chinois procèdent avec méthode, et ont parfaitement compris qu’un développement
technologique pérenne suppose une base mathématique de premier ordre. Pendant un temps,
ils ont encouragé l’expatriation de nombreux étudiants dans les meilleures universités américaines. Certains de ces étudiants ont préféré rester en Amérique, beaucoup sont revenus au
pays, et aujourd’hui, l’université chinoise tourne à plein régime. La politique menée a
répondu à des motifs « intéressés » : il s’agissait d’acquérir les moyens de la puissance. Mais si
cette politique a réussi, c’est qu’elle a pu faire fond sur des dispositions qui se sont prodigieusement amenuisées en Occident, alors qu’elles sont demeurées très vivaces en Extrême-Orient : à savoir le respect des choses de l’esprit, l’exigence intellectuelle, l’ardeur à l’étude. Il
est très stimulant de travailler dans un tel contexte. La question à laquelle je n’ai pas de
réponse est la suivante : est-ce que la Chine est prémunie contre l’évolution que nous
connaissons, ou bien ne fait-elle que bénéficier d’un retard de quelques décennies dans cette
même évolution ? Quoi qu’il en soit, son avantage présent est considérable.
— Peut-on être une puissance dans notre monde globalisé sans une grande maîtrise des mathématiques ?
— Non. Les sciences mathématiques de la nature ne sont pas des sciences de la nature, mais des
sciences de nos rapports opératoires avec la nature — de là, à la fois, leurs courtes limites philosophiques et leur prodigieuse puissance pratique. Et, comme le disait le lettré chinois, à
partir du moment où certains disposent de cette puissance, il faut en disposer également,
sans quoi « on reste plongé dans l’humiliation ».
Pour les pythagoriciens et les platoniciens, la réflexion géométrique était un exercice spirituel, par lequel l’âme apprenait à se détacher des réalités sensibles pour se tourner vers
l’intelligible. Il est toujours possible de pratiquer les mathématiques dans cet esprit
aujourd’hui. Mais depuis Platon, on a aussi découvert la puissance extraordinaire qu’elles
confèrent sur le monde sensible.
[1] « Que s’accomplissent les principes de la pédagogie avancée et que périsse l’école
française. »
*Olivier Rey est l’auteur de nombreux essais salués par la critique, comme « Quand le monde
s’est fait nombre » (Stock, « Les Essais », 2016), « Leurre et malheur du transhumanisme »
(Desclée de Brouwer, 2018) et « Réparer l’eau » (Stock, 2021). Il a également publié, sur le
Covid, « L’idolâtrie de la vie » (Gallimard, « Tracts », 2020).
Le cas du Vietnam, conservateur de l’ancien système français
Le Vietnam, dont le système scolaire « est profondément marqué par ce que la France avait mis
en place du temps de la colonisation, obtient aujourd’hui, précisément parce qu’il est
demeuré fidèle à cette empreinte, de bien meilleurs scores que notre pays dans les classements internationaux »
Le souci unique des réformes « de l’enseignement est d’inclure tout le monde, aujourd’hui
jusqu’au bac, demain peut-être jusqu’au doctorat. l’alignement sur les élèves en difficulté se
justifie par le fait que les autres, “ils s’en sortiront toujours”. Sans doute, mais à un niveau
inférieur à celui qui aurait été le leur si leurs capacités avaient été correctement cultivées »


_logo.svg.png)




.jpeg)