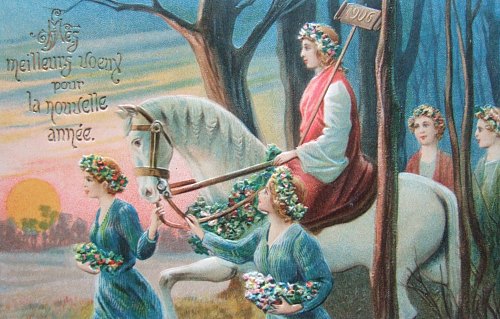Pour l’historien Stéphane Ratti dans l'article ci-dessous, la «tolérance» romaine à l’égard des pratiques religieuses relève en partie d’une construction postérieure. Rome moquait et punissait même sévèrement les cultes qui lui étaient étrangers. Stéphane Ratti est professeur émérite d’histoire de l’Antiquité tardive à l’Université de Bourgogne-Franche-Comté. Son dernier ouvrage: Histoire Auguste et autres historiens païens,
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2022.
Observer une réelle tolérance religieuse serait, dit-on, le meilleur moyen d’éviter les diverses tensions qui traversent les sociétés occidentales contemporaines. Il y a un peu moins de dix ans, en 2016, l’intérêt suscité par un ouvrage qui semblait dans son titre proposer, sous la plume de l’universitaire italien Maurizio Bettini, un Éloge du polythéisme, a conduit un peu vite la critique qui a rendu compte de l’ouvrage à célébrer les vertus du paganisme ancien comme s’il s’agissait d’un antidote magique aux fanatismes monothéistes. Or, il convient, même si, dans le contexte actuel, on saisit bien les enjeux, de nuancer les choses et de relativiser la tolérance des Anciens afin de mieux comprendre la véritable nature du paganisme gréco-romain.
Commençons par les sources latines anciennes afin de mettre un terme à un malentendu : la notion de tolérance est inconnue du monde gréco-romain, y compris de l’Antiquité tardive après la victoire du christianisme au IV
e siècle. La notion n’existait pas et aucun mot n’existe en latin pour dire la tolérance. En effet, Cicéron n’emploie qu’une seule fois le mot
tolerantia — il semble bien, en outre, que ce soit la première apparition de ce mot dans l’histoire de la littérature latine, un mot qui réapparaît plus tard chez Pétrone pour qualifier la complaisance des courtisanes — lequel mot désigne, dans un passage qui propose une définition du stoïcisme, la force de caractère qui permet de supporter l’adversité. Chez les Romains de l’époque classique
tolerantia est synonyme de
toleratio, l’endurance. Sous l’Empire, le philosophe Sénèque n’emploie le mot
tolerantia qu’à cinq reprises dans toute son œuvre et, chez lui, comme chez Cicéron, il s’agit de la vertu qui permet au sage de demeurer ferme en face de l’adversité, une vertu parfois aussi désignée par les termes de
constantia,
aequanimitas,
patientia ou encore
perpessio.
On ne se battait pas dans l’Antiquité pour des raisons religieuses. La chose demeure vraie jusqu’aux persécutions contre les chrétiens aux III
e et au début du IV
e siècle, à l’époque de l’empereur Dioclétien, puis, après l’édit de tolérance de Constantin en 313 jusqu’à la fin du IV
e siècle, à l’époque où l’on observe à nouveau d’importantes violences religieuses lors du conflit entre païens et chrétiens, par exemple la destruction du temple de Sérapis à Alexandrie en 392 ou le meurtre de la philosophe néoplatonicienne Hypatie en 415.
Cette relative indifférence à la religion de l’autre, une spécificité de l’Antiquité pendant des siècles jusqu’au IVe siècle, s’explique par le fait que, ni en Grèce ni à Rome, le paganisme n’est un choix ou un engagement, et ce pour une raison simple : on était païen comme on respirait autour de soi l’air méditerranéen, sur les bords du Mare nostrum ou plus loin dans les terres. On ne pouvait être rien d’autre que païen et d’ailleurs ce dernier mot n’existait même pas en latin (sauf sous la forme
pagani qui désignait les paysans dans les villages ou
pagi) : inutile de nommer ce qu’on était naturellement. Imaginons qu’aujourd’hui on veuille faire du paganisme une religion parmi d’autres, la décision apparaîtrait ipso facto comme un choix décidé par ses adeptes, ce qui ôterait incontinent à la nouvelle religion son innocence naturelle et primitive. On ne saurait aujourd’hui être païen qu’en vertu d’un choix et d’un refus – celui des grands monothéismes –, ce qui n’était pas le cas, et pour cause, dans l’Antiquité.
Le paganisme était, dit-on, polythéiste et par conséquent tolérant. Même l’éminent historien Paul Veyne le pensait, allant jusqu’à écrire, il est vrai dans un article de vulgarisation simplifiant quelque peu sa pensée, que « le monde antique avait vécu dans une tolérance universelle, comparable à celle des sectes hindouistes entre elles ». Dire le paganisme antique polythéiste et tolérant, c’est pourtant aller deux fois trop vite en besogne. La pluralité infinie des dieux du paganisme est sous-entendue par le préfixe grec, polu, mais une polyphonie n’est pas constituée d’un nombre infini de voix. Hésiode comptait certes, dans Les Travaux et les Jours, 30 000 dieux. Mais le caractère innombrable des dieux païens est aussi un mythe né des caricatures peintes par les chrétiens : c’est saint Augustin, dans les premiers livres de La Cité de Dieu, vers 413-415, notamment les livres IV et VI, qui a brocardé, à partir d’emprunts déformés et mal intentionnés à Varron, le nombre extravagant des dieux païens. Si on ajoute, comme le faisait saint Augustin, que les païens avaient en outre un dieu spécialisé dans les accouchements, un autre pour faire tomber la fièvre, d’autres encore pour veiller sur les bornes de propriété ou encore sur les égouts, on est sûr de son effet. On n’oubliera jamais que saint Augustin était non seulement un brillant rhéteur mais aussi maître en l’art de la satire : on décrédibilise le paganisme en infantilisant ses adeptes. C’était l’objectif du maître-livre de l’évêque d’Hippone. Combien de dieux connaissait réellement un Romain ordinaire ?
La question est celle-ci : les Romains étaient-ils tolérants en matière religieuse ? Bien sûr les Romains ont accepté d’importer à Rome des dieux étrangers, Cybèle, la déesse phrygienne de l’Ida, importée à Rome en 204 avant J.-C., en étant l’exemple le plus fameux à défaut d’être le plus représentatif, mais on pourrait aussi citer Mithra ou Isis, sans parler des dieux grecs. Les Romains « importaient » des dieux, mais ce verbe est inadéquat : ils les « romanisaient » plutôt, les débaptisaient même parfois (on sait que Jules César, dans La Guerre des Gaules, appelle tous les dieux gaulois de noms latins) et surtout les faisaient « leurs ». Et c’était d’ailleurs une cérémonie religieuse qui permettait de faire du dieu d’une cité ennemie vaincue un dieu romain désormais non plus hostile mais ami, la procédure de l’
euocatio. Scipion Émilien, par exemple, promit à la divinité de Carthage, en 146 avant J.-C., de lui offrir un sanctuaire en terre romaine. Nous possédons, grâce à l’un des derniers écrivains païens de Rome, Macrobe, actif au début du Ve siècle, le texte poétique, datant du IIe siècle avant J.-C., de la prière par laquelle on suppliait les dieux de l’ennemi de quitter leur panthéon d’origine pour migrer dans celui des dieux romains. La cérémonie, en outre, était strictement encadrée par les prêtres d’un collège spécialisé. Pour éviter d’ailleurs que l’ennemi ne fasse de même avec les divinités romaines la divinité Roma portait un nom secret, jalousement gardé.
La supposée tolérance romaine passait donc par un filtre institutionnel, patriotique et religieux et n’avait pas de caractère systématique ni le visage accueillant d’une tolérance idéalisée par certains de nos contemporains.
Interdictions, punitions et moqueries des cultes étrangers
Plusieurs épisodes dans l’histoire prouvent plutôt, et au contraire des idées reçues, l’intolérance de Rome envers les cultes étrangers. La crise la plus fameuse est celle que déclencha, en 186 avant J.-C., la découverte de pratiques secrètes associées au culte de Dionysos et qui provoqua le scandale des Bacchanales, connu pour nous par le fameux et fort détaillé récit de Tite-Live, scandale à la suite duquel le Sénat de Rome prononça de lourdes condamnations et engagea pour de longues années une féroce et systématique persécution contre les adeptes du culte de Dionysos soupçonnés, pour simplifier, de complot contre l’État et de licence morale. Les limites de la tolérance religieuse ne s’imposaient pas uniquement en temps de guerre mais aussi dans les contextes de crise politique. Sous l’Empire, Auguste, réprima le culte d’Isis tout en réorganisant profondément la religion romaine. Mécène, son conseiller, poussa le prince à la sévérité la plus grande envers les cultes étrangers selon le témoignage de l’historien grec Dion Cassius : « … que les fauteurs des cérémonies étrangères soient haïs et punis par toi, non seulement en vue des dieux, attendu que, lorsqu’on les méprise, il n’est rien autre chose dont on puisse faire cas ; mais aussi parce que l’introduction de nouvelles divinités engage beaucoup de citoyens à obéir à d’autres lois ; de là des conjurations, des coalitions et des associations que ne comporte en aucune façon un gouvernement monarchique ». L’empereur Tibère reprocha aux Gaulois la pratique de sacrifices humains (mentionnés par Tacite) et les fit interdire en même temps qu’il s’attaqua aux pratiques druidiques, ainsi que nous l’apprend Pline l’Ancien. Tibère encore, à la suite d’Auguste, voulut éteindre le culte d’Isis, fit brûler les vêtements et objets sacrés de ses adeptes et exila les Juifs en les menaçant d’une « servitude perpétuelle » aux dires de Suétone. L’empereur Claude, enfin, si l’on se fie à la thèse de Jérôme Carcopino, fit fermer la basilique souterraine de la Porte Majeure, à Rome, au motif que le culte pythagoricien représentait un danger religieux peut-être lié au fait que les stucs qui ornaient les plafonds et les murs de cette « église païenne » célébraient l’immortalité de la poétesse Sappho, un destin — l’apothéose — en principe réservé aux princes de l’Empire.
On le constate, bien avant les persécutions contre les païens, ni la liberté religieuse ni la tolérance à l’égard des cultes étrangers n’étaient, la plupart du temps, garanties à Rome. Bien avant ces persécutions l’étrangeté de certains cultes venus d’ailleurs suscitait incompréhension et moqueries. C’était le cas des divinités égyptiennes pourvues de têtes d’animaux ou encore des premiers chrétiens, caricaturés au IIe siècle, à Rome, comme adorateurs d’un dieu à tête d’âne, ainsi que le montre le célèbre graffito d’Alaxamenos, retrouvé sur le Palatin. À cette date la question du refus de la part des chrétiens de sacrifier en l’honneur de l’empereur ne se posait pas encore, seule l’étrangeté de ce culte nouveau dont on calomniait les croyances dérangeait.
Quant à la tolérance du paganisme impérial romain à l’égard du monothéisme chrétien, on sait bien ce qu’il en fut : si elle a été à de longues périodes la règle (en gros pendant les deux premiers siècles de l’Empire), elle s’est affaiblie en face de « l’entêtement » des chrétiens, pour parler comme Marc Aurèle dans ses Pensées pour lui-même et a tourné à la persécution lors de brefs et relativement limités épisodes paroxystiques, sous l’empereur Dioclétien, entre 303 et 311 notamment. Le paganisme institutionnel romain n’a pas pu indéfiniment tolérer une croyance religieuse qui niait le caractère sacré du principe impérial, celui de la personne même du prince.
Le paganisme, religion révélée
Les Romains, enfin, auraient-ils pu être tolérants par indifférence religieuse ? Il est, en effet, un aspect du polythéisme gréco-romain qui est particulièrement difficile à appréhender : c’est ce qu’on pourrait appeler, après Lucien Jerphagnon, le coefficient personnel de leur adhésion à la transcendance divine. On a généralement, à la suite de travaux des chercheurs américains notamment, suiveurs d’Alan Cameron, remis en question à la fin du siècle dernier « la croyance » des Anciens en leurs mythes : tout à leurs occupations commerciales, sociales et militaires, les Romains n’auraient réellement cru ni en leur mythologie ni en l’existence de leurs dieux, mais n’auraient eu qu’un goût d’antiquaires pour les textes de leur littérature ou même, au pire, fait semblant d’y croire. À vrai dire, on le sait, Cicéron déjà racontait qu’un prêtre païen, à Rome, ne pouvait en croiser un autre sur le forum sans échanger un sourire de connivence. C’est là, en réalité, largement caricaturer la complexité des mentalités anciennes et faire fi de ces poèmes funéraires gravés sur les tombeaux et qui donnaient ce conseil aux passants : « Croyez les mythes d’antan ! ».
Pour expliquer la tolérance des Romains, qui, on l’a compris, n’avait rien d’aussi solide qu’on le dit, on a souvent avancé que le paganisme n’était point une religion révélée et que les Anciens n’appuyaient leur croyance sur aucun livre sacré. Ils ne pouvaient donc nourrir aucune foi, tout juste respectaient-ils un formalisme ritualiste qu’on nomme parfois orthopraxie. C’est oublier que ce mot même de foi vient du latin fides. C’est négliger surtout toute une tradition intellectuelle et philosophique, celle de l’hermétisme et du néoplatonisme. Ces deux courants, sous l’Empire romain, du IIe au IVe siècles, ont nourri les grands esprits. Ils ont surtout inspiré toute une série d’ouvrages, la plupart en grec, qui forment comme la bible du paganisme. Ce sont des recueils « de sagesses révélées » selon la formule du grand savant chrétien André-Jean Festugière qui n’avait pas hésité à donner au magnifique livre qu’il leur consacra un titre révélateur, La Révélation d’Hermès Trismégiste. La dernière tentative de réhabilitation d’un paganisme d’État fut menée au IVe siècle par l’empereur Julien (361-363), auxquels les chrétiens revanchards donnèrent par la suite le cruel surnom de « l’Apostat ». Or Julien avait ressenti la nécessité, pour soutenir son entreprise politique et religieuse, de l’appuyer sur un catéchisme : il demanda à son ami le philosophe Saloustios, afin d’édifier la population, de rédiger un bref manuel du parfait païen. Nous avons la chance de posséder encore ce traité Des dieux et du monde qui résume ce qu’il faut savoir sur le sujet. Le paganisme était donc lui aussi une religion révélée, fondée sur des livres. Il était même la seule pensée à identifier absolument la culture livresque antique, des poèmes homériques aux traités néoplatoniciens de Plotin, Porphyre et Jamblique, en passant par Virgile, ce qu’on appelle la paideia, avec le trésor de l’enseignement des dieux.
Voir aussi
Afficher le nom des proscrits, c'est ainsi que mourut Cicéron en 43 av. J.-C.
Le télé-enseignement ? C’est très surfait, nous dit Platon