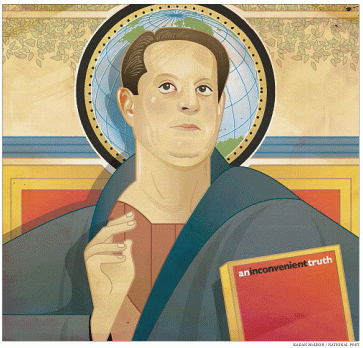Nous avions
déjà observé que la spiritualité autochtone figurait de manière totalement disproportionnée dans les manuels d'ECR destinés aux deux premières années du primaire. Nous avions alors étudié les manuels publiés par les éditions Modulo, les seuls agréés à l'époque par le MELS
selon leur site internet. Pas moins de 20 % des pages à contenu religieux de ces manuels étaient consacrés à cette spiritualité, alors que ceux qui s'identifiaient comme adeptes de cette religion représentaient, selon le recensement de 2001, environ 0,01 % de la population québécoise. La même disproportion avait notamment été observée par la suite dans
trois manuels du primaire des éditions CEC et
plusieurs cahiers d'activités d'ECR.
 |
| Illustration du manuel d'ECR Mélodie, publié par Modulo, destiné au 1er cycle du primaire, manuel B, p. 8 |
L'amérindien présenté comme l'apôtre de la nouvelle spiritualité dès l'enfance
On notera le fort relent écologique illustré par la page ci-dessus, tirée du manuel de l'élève B. Il est d'ailleurs intéressant de relever le fait que dans le domaine du soin de la Terre, l'enfant de 7 ans devra formuler sa réponse sous la forme de jugements de prescription (« Il faut... »). De nouveaux commandements écologiques ? En effet, les jugements de prescription « sont énoncés comme normes universelles auxquelles tous devraient se plier »
[1].
Dans certains manuels, comme ici, les seules prières sont des prières amérindiennes à la Terre-Mère. Pas de Notre Père avaient « expliqué » les auteurs des manuels Modulo, car il aurait alors fallu mettre des prières des autres religions. Faut-il comprendre que les prières de vagues spiritualités amérindiennes instrumentalisées à des fins écologistes sont acceptables, mais pas celles des religions organisées responsables de tous les maux ?
 |
L'harmonie autour du tipi...
Manuel CEC CEC 3e primaire
L'utopie est dans le tipi...
Manuel CEC 3e primaire, p. 37 |
Les religions, c'est mal. Une vague « spiritualité » autochtone, c'est bien
On pourrait croire que nous exagérons, mais le philosophe Georges Leroux, consultant pour le programme ECR et témoin gouvernemental en faveur de l'imposition sans exception du programme ECR aux procès de Drummondville et de Loyola, n'avait pas hésité à ressortir un poncif anticlérical des plus usés dans son expertise (page 26) :
« Alors que la période prémoderne se caractérisait par la recherche de l'hégémonie religieuse et par le prosélytisme qui conduisit l'Europe aux guerres les plus meurtrières de son histoire, la période moderne se caractérise par la sécularisation, la tolérance et le respect mutuel dans l'aire occidentale. » On voit bien que M. Georges Leroux est un spécialiste de l'antiquité tardive, de Plotin, car il semble ne pas connaître la grande intolérance des jacobins de la Révolution française
dont il se revendique pourtant, des nazis ou des communistes et des massacres qui ont accompagné leurs grands élans de sécularisation. Massacres et guerres bien plus meurtriers que celles de la période prémoderne où la composante religieuse était d'ailleurs souvent absente : quel est donc ce Roi Très-Chrétien français qui s'allie aux infidèles turcs pour prendre à revers le très catholique roi d'Espagne et empereur du Saint Empire romain germanique ? Les religions monothéistes, c'est mal. Une vague « spiritualité » autochtone, c'est bien.
L'indien est souvent représenté comme un écologiste précurseur, ce qui historiquement est douteux. Il semble servir à introduire les enfants à une noble cause universelle qui peut tous les unir, car on le répètera à satiété aux enfants la pollution ne s'arrête pas aux frontières, il faut que l'humanité entière se mobilise et cherche sa rédemption dans la protection de la Terre-Mère.
Animation pour les écoliers captifs pendant la Journée de la Terre, puis rituel autochtone
La notion de péché tient une place essentielle dans cette nouvelle « éthique planétaire » : gaspiller, ne pas recycler, ne pas trier sélectivement, pour certains faire des enfants, voilà autant d’actes égoïstes qui mettent la planète en danger et qu’il faut donc condamner. Lors de Journées de la Terre où sont « conviés » par classes entières les enfants captifs des écoles du Monopole de l'Éducation, des animateurs conscientiseront les enfants, entretiendront la flamme grâce à des ateliers et à des
histoires, chants et symboles où réapparaissent les traditions autochtones, ces premiers écologistes qui ont tant à nous apprendre...
L'Amérindien, un écologiste dont on peut être fier ?
Selon
Sylvie LeBel qui cite, Denys Delâge, historien de l'université Laval, les Amérindiens n'étaient pas plus écologiques que nos ancêtres paysans. Le jésuite Paul Le Jeune, dans la
Relation de 1635, s'inquiétait de la surexploitation du castor par les Indiens du Canada. Il relate de quelle façon les Montagnais les tuaient tous dans leurs huttes, alors qu'il leur conseillait d'y laisser au moins quelques petits afin qu'ils se reproduisent. Le Père de Charlevoix écrivait dans son
Journal historique en 1721 comment les chiens étaient parfois immolés ou suspendus vivants à un arbre par les pattes de derrière jusqu'à ce que mort s'ensuive lorsque les Amérindiens devaient franchir des rapides ou des passages dangereux.
Le père Louis Nicolas relate dans son
Histoire naturelle des Indes qu'il avait vu des Amérindiens couper des arbres entiers pour en ramasser les noix ou accéder aux nids d'oiseaux. Les autochtones avaient aussi coutume d'allumer des feux pour fertiliser les forêts de pins ou faciliter le transport. Mais les Amérindiens perdaient parfois la maîtrise de ces incendies et, outre la pollution qu'ils créaient ainsi, ils détruisaient de la sorte inutilement nombre de plantes et animaux.
 |
Une fierté autochtone valorisée.
Illustration du manuel d'ECR Diapason, publié par Modulo, destiné au 2e cycle du primaire, manuel A, p. 6) |
Pourquoi cette image de l'Amérindien écologiste existe-t-elle aujourd'hui si elle ne correspond pas à la réalité historique ? Selon l'anthropologue américain
Shepard Krech III, ce sont les Blancs qui ont créé ce mythe durant les années 1960, parce qu'ils avaient de nouvelles préoccupations pour l'environnement. Krech croit que les Amérindiens n'ont jamais été écologistes dans le sens moderne, mais qu'ils ont peu à peu adhéré ces dernières années à ce stéréotype avantageux aujourd'hui qu'ils utilisent pour revendiquer de meilleures conditions d'existence. Et s'ils n'ont pas causé de dégâts importants malgré des comportements parfois peu écologiques, c'est tout simplement parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux.
L'écologie, la nouvelle religion universelle ?
On peut se demander si l’accent mis sur l’Amérindien, écologiste modèle, en partie mythique comme nous l’avons vu, ne joue pas le rôle de figure tutélaire d’un nouveau mouvement : l’écologisme universel. Cette religion ou éthique planétaire permettrait de dépasser les vieux clivages culturels et religieux hérités des religions régionales considérées aujourd’hui comme des obstacles à la bonne entente des peuples de la Terre.
Selon le président tchèque Vaclav Klaus,
interrogé par l’Institut CATO, il ne faut pas confondre l’écologisme avec la défense raisonnable de l’environnement. Pour Klaus, « L’écologisme est une religion, elle ne fait pas partie des sciences naturelles, mais se rapproche plus des sciences sociales. » Cette religion purement « étatiste » a pour but de voir des technocrates diriger les peuples, brebis égarées toujours susceptibles de polluer la planète. Klaus affirme que cette religion va de pair avec le « multiculturalisme », l’« internationalisme » et la « démocratie sociale » et d’autres idéologies à la mode qui visent à mettre en place au plus vite le « supranationalisme ».
À la lecture des succès de librairie d’Al Gore,
Une Vérité qui dérange et
Sauver la planète Terre, il faut avouer que sa vision est purement planétaire. Témoin son «
Plan Marshall global ». Celui-ci mettrait en place une fiducie qui permettrait la création de produits écologiques. Les fonds nécessaires seraient prélevés auprès des agresseurs de la « Mère Terre », plus particulièrement les industries qui émettent une grande quantité de dioxyde de carbone. Gore prône également dans sa future écothéocratie une éducation écologique universelle afin que
les écoles « surveillent la planète entière ».
Le christianisme en prend pour son grade dans cette nouvelle religion. En effet, l’élimination par le christianisme du paganisme animiste qui associait à tout être vivant une âme aurait ouvert la voie à l’exploitation sans frein de la nature. Comme la cause de nos maux est religieuse – les religions révélées qui placent l’homme au centre de la création – le remède au saccage moderne de Gaïa (la Terre comme organisme vivant) se doit d’être d'essence religieuse ou éthique. Une religion de la nature parfaitement adaptée à l’athée urbain du XXI
e siècle.
Chandelles votives, dogmes, pèlerinages, icônes et salut
Cette religiosité connaît son canon et ses saints : au Canada, il suffit de penser à David Suzuki, au Québec à l’inusable Jacques Languirand, et aux États-Unis à Al Gore. Le rapport du GEIC tient lieu d’Écriture sainte. À ce titre, la découverte du réchauffement climatique a comblé une lacune dans le canon écologiste : cette catastrophe annoncée permet enfin de condamner les péchés d’un passé occidental dépourvu de conscience écologique.
Cette religiosité est bien vivante, elle se perçoit dans le frisson de piété qui saisit l’adepte quand il allume ses ampoules à basse consommation, ses chandelles votives modernes. Sa foi n’ignore pas plus les icônes, ces ours polaires faméliques que publie la presse pieuse. (Rappelons qu'
en réalité la population des ours polaires aurait doublé depuis 40 ans après la mise en place de mesures visant à limiter la chasse de ce grand carnivore.)
Ses dogmes ne supportent plus le questionnement. Combien de fois n’a-t-on pas lu dans la presse fervente que « le débat entourant les gaz à effet de serre apparaît clos » ? Voir par exemple le Toronto Star, le 28 janvier 2008.
La notion de péché tient une place essentielle dans cette nouvelle « éthique planétaire » : gaspiller, ne pas recycler, ne pas trier sélectivement, pour certains faire des enfants, voilà autant d’actes égoïstes qui mettent la planète en danger et qu’il faut donc condamner.
Les adeptes les plus ardents font leurs pèlerinages qu’ils nomment écotourisme. Une dîme s’impose aux membres du culte qui voyagent par avion ou se chauffent au mazout ; elle servira à compenser ces péchés par la plantation d’arbres dont le prix est religieusement établi par des sociétés qui ont pignon sur Internet.
Ce qu’on nommait le salut dans les religions antiques qui divisent le monde est devenu la « développement durable », expression floue qui sied à ce nouvel état de grâce.
Démystifier les prêcheurs d’apocalypse par des arguments scientifiques, œuvre salutaire qu’ont entreprise plusieurs scientifiques français
[2] [3], ne mettra sans doute pas fin à la volonté de ces prêcheurs d’imposer leur programme et leur optique à tous. En effet, nous avons affaire ici à une idéologie qui ne cherche pas seulement à sauver la planète, mais qui vise aussi à rassembler par ce biais les peuples de la Terre unis dans une nouvelle cause sous l’égide d’instances supranationales – la pollution ne s’arrête pas aux frontières, nous répète-t-on ! – pour le bien de l’humanité. On retrouve cette même fascination pour
l’internationalisme dans les nouveaux manuels d’histoire et d’éducation à la citoyenneté imposés par le Monopole de l’éducation du Québec.
Il y a une certaine logique à ce que les technocrates étatistes imposent — pardon, proposent ! — dans les programmes scolaires cette sensibilité écologiste puisqu’elle justifie l’étatisme éclairé assuré par des technocrates, demain peut-être supranationaux, comme eux.
Ce qui est plus étonnant, c'est le fervent soutien dont bénéficie ce genre d'instruction auprès de la soi-disant élite nationaliste québécoise. Cette même élite s'étonne ensuite que la jeunesse du Québec songe plus à l'écologie et à l'ouverture sur les cultures du monde qu'à la sauvegarde culturelle et identitaire du Québec. Ce désintérêt pour le vieux fonds de commerce nationaliste n'a rien d'étonnant puisque les gouvernements nationalistes successifs (PQ) ont tous approuvé qu'on inculque aux enfants du Québec les mêmes valeurs que celles prônées par la gauche représentée par le NPD
[4]... Même les jeunes du parti dit de centre droit (PLQ)
demandent au gouvernement d'être plus écologique.