
Il faudra encore patienter avant de savoir si la Cour d’appel entendra la cause des parents d’élèves fréquentant des établissements de la Commission scolaire des Chênes, à Drummondville, et qui souhaitent que leurs enfants soient exemptés du controversé cours gouvernemental d’éthique et culture religieuse (ECR).
Les juges Marc Beauregard, Yves-Marie Morissette et Lorne Giroux ont choisi de prendre la requête en délibéré. Ils rendront leur décision par écrit dans les prochaines semaines, à une date qui reste à déterminer.
Près d'une vingtaine de parents du Québec ont assisté à l'audience ce lundi matin et,
selon la journaliste de la Presse présente sur place, ont vivement manifesté leur souhait que l'appel soit entendu. « Le cours d'éthique enseigne le relativisme religieux comme une doctrine. On s'oppose à ça », dit Jean Servais, qui souhaite que sa fille soit exemptée du cours.
L'an dernier, 2 300 parents ont demandé que leurs enfants ne suivent pas le cours ECR. « Mais plusieurs parents, comme moi, n'ont pas osé se lancer dans une longue bataille judiciaire, note M. Servais. C'est pour ça que la cause de M
me Lavallée est si importante. Elle et ses enfants se battent pour nous tous. » Rappelons que les frais associés à la défense des parents Lavallée s'élèvent à plus de 100 000 $, que la mère et le fils ainé ont été soumis à deux reprises à de longues séances d'interrogatoire de plusieurs heures avant le procès et qu'ils ont participé à un procès d'une semaine tenu en mai à Drummondville.
Écoutez M
e Jean-Yves, avocat des parents, expliquer une des erreurs de droit qu'il invoque pour aller en appel :
Motifs de l'inscription en appel (PDF 15 pages).
Requête en rejet d'appel de la procureure générale (PDF 12 pages).
Un lundi à la Cour d'appelLe bâtiment de la Cour d’appel du Québec est un bâtiment néo-classique à l’élégance sévère. Sa façade est composée de quatorze colonnes de style dorique en granit. Gravissant les degrés de l’escalier, le visiteur traverse d’abord l’hémicycle du porche dans l’œuvre où trônent deux grandes torchères de bronze puis les deux lourds vantaux du portail couverts de bas-reliefs allégoriques représentant la justice, le châtiment et la vérité. En haut d’un des battants, la maxime gravée « Dura lex, sed lex ».
Le contrôle de sécurité se situe à l’entrée de la salle des pas perdus. Cette grande bâtisse est quasi vide en cette matinée pluvieuse. On croise quelques avocats qui se précipitent vers leur vestiaire pour y revêtir leur toge et achever leurs derniers préparatifs. Des parents commencent à arriver, consultent le rôle affiché à côté de l’entrée de la salle d’audience : l’affaire Lavallée est la quatrième. Il est 9 h 30, on ouvre les portes.
Le bas de la salle est couvert de lambris, au fond le banc des juges et derrière celui-ci un panneau de bois qui devait accueillir un grand portait désormais absent et puis, bien haut, les armoiries du Royaume-Uni supportées à dextre par un léopard et à senestre par une licorne au pied desquels on peut lire « Dieu et mon droit ». La salle est éclairée par un grand plafonnier d’albâtre en forme de vasque parcourue de veines brunes ainsi que des appliques dans ce même style Art déco.
Les trois juges pénètrent. Ils s’asseyent. Au centre, le juge qui mènera les débats : le juge Marc Beauregard à l’ample chevelure blanche, à sa droite Yves-Marie Morissette aux cheveux de jais, et à sa gauche Lorne Giroux également chenu. Ces juges sont réunis ce matin pour décider si les affaires qui leur sont présentées sont recevables et seront entendues en appel. Les deux premières affaires sont prestement expédiées et l’appel leur est refusé. Ne sortent alors que les avocats impliqués et leur client. Aucun sympathisant apparemment. La troisième affaire traîne en longueur, un volubile avocat grec à l’accent impénétrable se défend en anglais. Il insiste lourdement sur ses diplômes. Les juges se retirent. Puis intervient la pause de quinze minutes prévues pour le matin. Les juges réapparaissent, le petit avocat grec veut rajouter quelque chose. Il parle encore. Enfin, les juges se retirent, reviennent et décident d’en délibérer plus longuement entre eux. La décision de pouvoir en appeler sera donc communiquée ultérieurement. Sortent quelques avocats et la sœur du juriste hellène qui l’avait accompagné au tribunal.
Enfin ! C’est le tour de l’affaire Lavallée. Trois journalistes sont dans la salle : Radio-Canada, La Presse et la Gazette. Pour les parents, leur avoué M
e Côté. Du côté des pouvoirs publics, trois avocats : M
e Boucher et la jeune M
e Jobin pour le procureur général du Québec et le chevronné et toujours courtois M
e Lapointe pour la commission des Chênes.
Il est près de onze heures. Le procureur M
e Boucher, personnage sec aux cheveux poivre et sel, avance de manière éloquente les arguments du gouvernement du Québec pour refuser l’appel aux parents de Drummondville. Il maîtrise bien son dossier et n’affiche aucune nervosité derrière une courtoisie parfois obséquieuse à l’égard des juges et de son éminent confrère.
Pour M
e Boucher, l’affaire devrait être refusée, car son objet est devenu purement théorique : le seul enfant des Lavallée encore soumis au cours d’ECR, l’ainé étant désormais au cégep, ne fréquente plus l’école publique, mais une école privée où il bénéficierait d’une exemption. Le juge Beauregard interrompt immédiatement le procureur : il est évident que l’enfant peut revenir au public à tout moment. Rien n’indique dans les documents déposés que ce sera le cas de répondre l’avocat gouvernemental.
Le procureur invoque ensuite une série d’articles de la Loi sur l’instruction publique (LIP §§ 9-12) pour prétendre que la Cour d’appel n’est pas le lieu où devrait être entendue cette contestation, mais qu’il existe un processus prévu dans la LIP pour réviser ces décisions. Le conseil des commissaires scolaires, un tribunal quasi judiciaire, serait l'instance appropriée. Le juge Morissette trouve cette interprétation « pas mal inventive ».
M
e Boucher prétend ensuite que la requête d’en appeler lui est parvenue avec retard. Elle lui aurait été signifiée par huissier un jour trop tard. Il omet de dire qu’il avait reçu une version par télécopieur quelques jours auparavant. Nous y reviendrons.
Pour l’austère procureur, la cause étant devenue sans objet, la Cour doit ne plus l’entendre. Un des juges ajoute « sauf exception ». M
e Boucher concède, mais il en va selon lui de l’économie des ressources judiciaires : quel droit resterait-il à débattre ? Il évoque alors l’affaire Loyola qui pourrait avoir une influence sur cette affaire. Cette évocation nous est apparue très floue. Selon le procureur, les deux causes en question seraient similaires, pourquoi faire entendre en appel deux affaires quasi identiques ?
M
e Boucher de se demander alors si cette affaire ferait avancer le droit ? À qui d’autre pourrait-on l’appliquer ? Ce genre de cause ne peut s'étudier qu’au cas par cas, puisque c’est la foi sincère du requérant qui est en cause. On ne voit donc pas comment faire avancer le droit. Que reste-t-il donc ? Assister au cours d’éthique et de culture religieuse est une obligation fixée par la Loi et le Régime pédagogique. La loi n’est pas contestée par la partie adverse. Visiblement, ici, le procureur marque un point. Enfin, M
e Boucher suggère que l'intention non avouée des appelants serait de remettre en cause la constitutionnalité de la Loi.
Il est passé midi et demi quand M
e Boucher clôt sa plaidoirie. L’avocat des parents ne sera entendu que lorsque l’audience reprendra à 14 h.
L'après-midiIl est quatorze heures, l’avocat des parents Lavallée, Jean-Yves Côté, s’avance et fait distribuer une série de classeurs remplis de documents aux juges et aux avocats de la partie adverse.
M
e Coté, dont la voix est d’abord hésitante, indique d’emblée aux juges que les affidavits qui accompagnent les requêtes en rejet d’appel soumises par le procureur général et la commission scolaire sont grevés de multiples faussetés et qu’il faut donc les rejeter.
Il en indique plusieurs : il est inexact de dire que sa demande d’en appeler a été transmise en retard. La date mentionnée par le procureur comme le début du délai de 30 jours pour faire appel est incorrecte, car le procureur prend comme date de départ la réception d’un courriel (en deux parties!) de la part du juge qui n’était – dans les termes mêmes du juge Dubois dans une lettre ultérieure – qu’un courriel de courtoisie et en rien un moyen de signifier prévu par la loi à cet effet. Le jugement n’a été transmis par courrier postal que le lendemain et donc la requête de M
e Côté a été transmise à point nommé par huissier aux différentes parties.
Autre fausseté : l’enfant Lavallée ne bénéficie d’aucune exemption dans son école privée. Il faut, en effet, bien distinguer deux choses : le droit d’exemption et le retrait. Le droit d’exemption est prévu de manière explicite par la loi, dans des termes similaires pour l’école publique et privée, et il implique que l’enfant reste à l’école, mais aille par exemple à la bibliothèque pendant la durée du cours dont il est exempté. Le retrait, par contre, comme il apparaît clairement dans
une ordonnance de sauvegarde émise dans le cadre des élèves menacés d’expulsion à Granby, implique que les parents viennent « quérir leurs enfants à l’école ». Dans le cas de M
me Lavallée, elle ne bénéficie d’aucune exemption dans son école privée, mais d’une simple permission de retrait comme c’était le cas l’année passée au public. Il n’y a pas de différence à ce niveau.
M
e Côté a aussi souhaité lever une équivoque, « un flou » artistique entretenu par la partie adverse : les écoles privées sont aussi tenues de donner le cours d’éthique et de culture religieuse, l’enfant des Lavallée n’y bénéficie pas d’une exemption par le simple fait d’être dans un collège privé.
Quant à l’aspect théorique invoqué par l’avocat de la procureure générale pour tenter de discréditer le recours, il est évident que l’enfant peut revenir au public à tout moment. Ce fut déjà le cas de son frère aîné, désormais au cégep, qui a alterné entre le secteur public et privé entre autres pour bénéficier du programme de sport-études. M
e Côté a alors rappelé une longue série de cas accueillis par la Cour d’appel dont l’objet aurait pu paraître théorique : l’affaire Tremblay
c. Daigle, par exemple, qui a été portée en appel même si l’avortement auquel s’opposait M. Tremblay avait déjà été perpétré. Ou encore l’affaire Multani où le jeune sikh avait quitté l’école publique où on lui interdisait le port de son petit poignard pour fréquenter l’école privée pendant que la cause était portée en appel.
Pour ce qui est du collège Loyola, il s’agit d’une affaire très différente. L’école ne demande pas d’être exemptée du cours d’éthique et de culture religieuse, mais comme la Loi le permet, de présenter un cours équivalent proche du cours d’éthique et de culture religieuse. Mais encore là, la cause a été entendue même si l’élève Zucchi nommé dans cette cause, était en secondaire 3, année où le cours ne se donne pas.
L’avocat de la famille Lavallée a également insisté sur la nature récurrente liée à la demande d’exemption annuelle conformément à l’article 222 – les parents devraient demander chaque année une exemption et ne pourraient la contester dans la même année devant les tribunaux – qui milite en faveur d’une décision judiciaire qui clarifierait les règles d’application de cet article. M
e Côté n'élabore cependant pas.
Enfin, est-on confronté ici à un cas unique ou à portée collective ? Le procureur général prétend qu’il s’agit ici d’une affaire à juger au cas par cas puisqu’il s’agit de juger la foi sincère. Or, d’une part, le refus d’exemption de la Commission scolaire des Chênes a frappé 19 enfants en même temps après qu’elle eut entendu M
e Côté faire une présentation au nom de tous ces parents. D’autre part, le juge Dubois a lui-même conféré un caractère collectif à sa décision en liant son jugement à l’opinion d’un théologien catholique, tout en admettant que la croyance sincère de la mère était bien établie, car selon lui celle-ci n’était pas suffisante. M
e Côté prévoit que ce jugement pourrait s’appliquer à tous les catholiques puisque, même si un catholique a la croyance sincère que ce cours va à l’encontre de ses convictions, un théologien embauché par le gouvernement a déclaré, selon le juge Dubois, que le cours n’allait pas à l’encontre de la doctrine et de la foi catholiques.
Confronté aux arguments du juge Giroux qui faisait entendre que la demande d’exemption des dix-neuf enfants en question n’avait pas été jugée à Drummondville et que seule celle des deux enfants Lavallée l’avait été, M
e Coté a rappelé que lui aussi devait garder à l’esprit l’économie des ressources judiciaires et que défendre 19 enfants aurait signifier de très nombreux interrogatoires supplémentaires et une cause nettement plus longue que ni l’État ni les familles ne pouvaient s’offrir. Dans un rare mouvement d’indignation, M
e Côté a ensuite indiqué que les parents subissaient un traitement inéquitable : s’ils devaient gagner, leur victoire ne s’appliquerait qu’à eux seuls selon la partie adverse, les autres parents devant eux aussi passer en justice, mais maintenant que les Lavallée avaient perdu en première instance on refusait collectivement toute exemption en disant aux parents intéressés que l’affaire avait été jugée. Deux poids, deux mesures inacceptables.
Le seul avocat des parents a par la suite abordé la question de la « dictée d'un tiers », à savoir que les commissaires auraient abdiqué la décision d'accorder une exemption à un tiers alors que cette responsabilité leur revient. À cet effet, il a mentionné que les lettres provenant d’une commission scolaire du Saguenay étaient à peu près identiques à celles issues de la C.S. des Chênes ainsi qu'à plusieurs autres commission scolaires.
Enfin, M
e Côté, les juges et M
e Boucher discutèrent de la demande de l'avocat des Lavallée d’avoir une copie gratuite ou payée par le procureur général des notes du procès de Drummondville, notes déjà produites et payées par le gouvernement et disponibles pour les procureurs de l'État pendant les 2 semaines où M
e Côté rédigeait sa plaidoirie alors que les procureurs avaient refusé de les partager avec l'avoué des parents. Le juge a demandé quels droits d’auteur s’appliquaient, question à laquelle l'avocat des parents n’a pas pu répondre. Par la suite, M
e Boucher a indiqué qu’il ne pouvait pas partager sa copie qui était annotée et que M
e Côté pouvait en obtenir une copie auprès de la sténographe pour 60 cents la page plutôt que les 3,50 $ que le gouvernement avait déboursés par page.
Le juge Beauregard demande ensuite à M
e Côté : « Que devez-vous prouver ? », question un peu ambiguë. M
e Côté revient sur le fait que la cause en appel a un objet bien concret et n’est pas théorique même si l’enfant Lavallée ne fréquente pas actuellement l’école publique. Il ne développe pas l’argument de fond concernant les points sur lesquels il croit que le juge Dubois a erré.
M
e Côté demande si les juges veulent en entendre plus au sujet des faussetés dans le texte de M
e Jobin. Le juge Beauregard déclare que non.
Le juge Beauregard veut alors lever la séance pour aller délibérer en privé. À ce moment M
e Lapointe l’avocat représentant la commission scolaire demande à prendre la parole. Le juge Beauregard lui dit : « Je croyais que le procureur général avait également parlé pour vous. J’imagine que vous devez exprimer le même point de vue ». Ce à quoi M
e Lapointe réplique qu’il a des points à rajouter. Le juge Beauregard accepte et lui accorde une bonne dizaine de minutes.
La séance se termine par cet étrange retour des avocats représentant le ministère de l’Éducation et la commission scolaire, alors que selon le rôle, M
e Côté devait être le dernier à parler. M
e René Lapointe vient à la barre dire que la commission scolaire avait suivi le processus prévu par la Loi à l’article 222 et qu’il ne voyait vraiment pas pourquoi des ressources supplémentaires devraient être dépensées pour entendre cette cause en appel et, sans doute, jusqu’à la Cour suprême. L’avocat de la commission scolaire ajoute qu’il est faux de prétendre, comme M
e Côté l’a fait, que le juge Dubois a réuni l’affaire des enfants de Granby à ceux de Drummondville. L'avocat chevronné de la commission scolaire déclare que la cause de Drummondville impliquait un demandeur et la Commission scolaire. Il prétend que si c’est la cour venait à décider à la place de la commission scolaire ce qui constitue un préjudice grave, elle « détourne l’article 222 de la LIP ». La question à savoir si les élèves « subiraient un préjudice grave » a été posée. M
e Lapointe indique qu'il existe une procédure claire dans la Loi et les parents n’avaient pas réussi à prouver devant les commissaires scolaires qu’ils subissaient un « préjudice grave », l'affaire était close. Il passait là sous silence les critiques que M
e Côté avait mentionnées plus tôt : les commissaires n'avaient pas considéré parmi les préjudices graves l'atteinte à une des libertés protégées par les chartes : la liberté de conscience et de religion et le critère à appliquer dans ce cas : la croyance sincère des parents. Pire ils avaient même écrit que cet aspect n'était pas de leur ressort et que c'était aux tribunal de trancher. M
e Lapointe a terminé son intervention en ajoutant que le juge Dubois avait décidé qu’il n’y avait pas de dictée d’un tiers. Le juge Beauregard lui demande si c’est « discutable ou clair », car selon lui la question de la dictée d’un tiers est primordiale. M
e Lapointe dit que « c’est clair ».
M
e Boucher en profite pour reprendre la parole et affirmer tout de go que de nombreuses affirmations de son éminent confrère de la partie adverse sont fausses. Sans préciser. M
e Boucher prétend alors que tout a déjà été jugé par le juge Dubois qui aurait entendu tous les témoins particulièrement en ce qui concerne la question de la dictée d’un tiers et que, pour ce qui est de l’influence indue qu’auraient subie les commissaires pour qu’ils refusent toutes les exemptions, elle n’a pas pu être prouvée, car la seule preuve de la partie adverse était une conférence de presse qu’aurait tenue la ministre et que, comme l’a démontré le procès, les commissaires n’étaient même pas au courant de celle-ci !
Les juges se retirent alors sans donner l’occasion à M
e Côté d’intervenir. Ils reviennent quelques minutes plus tard pour annoncer qu’ils se prononceront par écrit après en avoir délibéré. La salle se vide alors, ne restent plus que quelques avocats et leurs clients pour les affaires restantes de la journée. Dans les couloirs, les parents ne peuvent cacher leur déception de ne pas être fixés dès aujourd’hui et de ne pas avoir obtenu le droit à l’appel. Les journalistes de la Gazette et de La Presse s’affairent et posent des questions aux parents et à M
e Coté. Ils désirent surtout savoir quand le jugement sera prononcé. M
e Côté prévoit que cela pourrait prendre de quelques jours à deux semaines. Les autres avocats ont disparu. La télévision de Radio-Canada qui avait filmé les parents sortant du tribunal le matin n'est plus là en fin d'après-midi.

Directeur d'école qui donne une interprétation collective à la décision du juge Dubois
Soutenons les familles dans leurs combats juridiques (reçu fiscal pour tout don supérieur à 50 $)






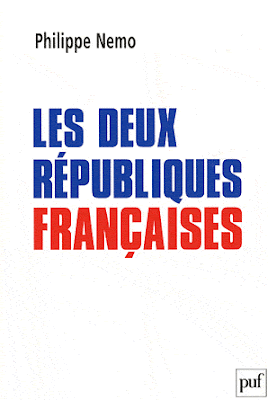
 Il faudra encore patienter avant de savoir si la Cour d’appel entendra la cause des parents d’élèves fréquentant des établissements de la Commission scolaire des Chênes, à Drummondville, et qui souhaitent que leurs enfants soient exemptés du controversé cours gouvernemental d’éthique et culture religieuse (ECR).
Il faudra encore patienter avant de savoir si la Cour d’appel entendra la cause des parents d’élèves fréquentant des établissements de la Commission scolaire des Chênes, à Drummondville, et qui souhaitent que leurs enfants soient exemptés du controversé cours gouvernemental d’éthique et culture religieuse (ECR).
 La gauche « laïque » (y avait-il un croyant ?) organisait un colloque sur l'école et le cours ECR, école québécoise déjà victime de la mainmise de la gauche sur l'éducation et de l'imposition d'un monopole de l'Éducation cher à la gauche qui se dit « républicaine ».
La gauche « laïque » (y avait-il un croyant ?) organisait un colloque sur l'école et le cours ECR, école québécoise déjà victime de la mainmise de la gauche sur l'éducation et de l'imposition d'un monopole de l'Éducation cher à la gauche qui se dit « républicaine ». 
 Ceci étant, l'ingénieur diplômé des chemins de fer et docteur en économie, co-titulaire du Prix Nobel de la Paix (avec Al Gore et le GIEC), président du GIEC, R. K. Pachauri a, tout de même, une curieuse façon de s'exprimer pour un « grand scientifique climatologue » (comme disent les médias). Voilà qu'il qualifie une étude effectuée par un éminent glaciologue, d'arrogante ou de science vaudou, après avoir déclaré, il y a deux ans, que la théorie de Svensmark et coll. sur l'influence des cycles solaires sur le climat (actuellement testée au CERN de Genève) était « extrêmement naïve et irresponsable »...
Ceci étant, l'ingénieur diplômé des chemins de fer et docteur en économie, co-titulaire du Prix Nobel de la Paix (avec Al Gore et le GIEC), président du GIEC, R. K. Pachauri a, tout de même, une curieuse façon de s'exprimer pour un « grand scientifique climatologue » (comme disent les médias). Voilà qu'il qualifie une étude effectuée par un éminent glaciologue, d'arrogante ou de science vaudou, après avoir déclaré, il y a deux ans, que la théorie de Svensmark et coll. sur l'influence des cycles solaires sur le climat (actuellement testée au CERN de Genève) était « extrêmement naïve et irresponsable »...