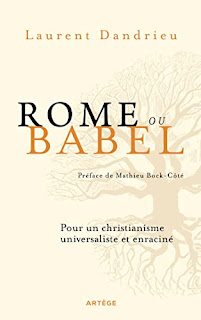Un point de bascule sera vraisemblablement franchi en 2023. Cette année, le Québec devrait compter un plus grand nombre de thèses et de mémoires publiés en anglais qu’en français.
C’est l’un des constats qui émerge de la mise à jour d’une étude que Jean-Hugues Roy a présentée à la fin avril dans le cadre du forum La science en français organisé par les Fonds de recherche du Québec.
Un corpus de 110 000 documents
Comment est-il arrivé à ces résultats ? Il a compilé la liste de l’ensemble des thèses et des mémoires disponibles dans les répertoires institutionnels de 17 des 20 universités du Québec.
M. Roy avait effectué ce travail une première fois en 2016 pour le Magazine de l’Acfas. À l’époque, il ne m’intéressait qu’à la longueur de ces documents, par grade, par discipline, par université.
Il a mis à jour cette étude cinq ans plus tard, en y ajoutant un volet dans lequel il a examiné la langue dans laquelle a été rédigé chaque document. Ses données couvraient les années 2000 à 2020 et la croissance de l’anglais était manifeste.
Il a fait une nouvelle mise à jour pour inclure les années 2021 et 2022 et vérifier si l’anglicisation des documents attestant des diplômes des cycles supérieurs se poursuivait. Elle se poursuit.
Son corpus comprend quelque 110 000 thèses et mémoires publiées au cours des 23 dernières années (2000 à 2022). Au cours de cette période, un peu plus de 62 % de ces documents qui attestent du parcours d’une personne aux cycles supérieurs ont été rédigés dans la langue de Molière.
Le graphique ci-dessous montre comment les langues se répartissent en fonction du grade octroyé. À la maîtrise, 33,4 % des mémoires ont été rédigés en anglais, et c’est le cas de 46,3 % des thèses au doctorat. En somme, depuis le début du siècle, un mémoire de maîtrise du trois et une thèse de doctorat sur deux a été écrite en anglais, au Québec.
Évolution dans le temps
Quand on répartit les données en fonction des années, on se rend compte de la croissance de l’usage de l’anglais depuis une vingtaine d’années.
Figure 2.Les proportions indiquées avant 2007 sont peu représentatives, puisque les répertoires institutionnels contiennent moins de documents publiés ces années-là. Mais depuis, la tendance est claire. En 2022, sur les 4 452 thèses et mémoires trouvés dans les répertoires institutionnels au moment de la compilation de M. Roy (février 2023), 2 200 étaient rédigés en anglais, 2 248 l’étaient en français et quatre dans une autre langue. Si cette tendance se maintient, l’anglais dépassera le français en 2023 pour la production aux cycles supérieurs au Québec.
En distinguant les mémoires et les thèses, le portrait se raffine.
Figure 3.
Au deuxième cycle, on compte encore une majorité de mémoires publiés en français. Mais au troisième cycle, le français est minoritaire depuis 2018 déjà.
Situation dans les universités francophones
Cette prédominance de l’anglais s’explique peut-être parce que les deux universités anglophones de Montréal, McGill et Concordia, comptent pour près du tiers des documents que l’on retrouve dans les répertoires institutionnels québécois. Excluons-les pour ne se concentrer que sur les 15 universités francophones du Québec.
Les deux graphiques ci-dessus montrent que la langue française y est plus vigoureuse. L’anglais progresse néanmoins de telle manière qu’en 2022, une maîtrise sur six et un doctorat sur trois publié dans l’une des 15 universités francophones du Québec l’a été dans la langue de Rutherford.
Répartition par institution
Les deux graphiques ci-dessous, qui présentent la proportion de mémoires et de thèses publiés en anglais par année, et par institution, montrent que la situation n’évolue pas au même rythme partout.
Figure 7.
Ils montrent assez clairement que c’est au doctorat que ça se passe, notamment dans les universités qui se spécialisent en génie. En 2021 et 2022, 198 des 304 doctorats décernés à Polytechnique Montréal et à l’ÉTS l’étaient sur la base d’une thèse écrite en anglais (65 %).
Raffiner les métadonnées
Cela dit, au Québec, il est rare qu’une thèse ou qu’un mémoire soit rédigé intégralement en anglais. On trouve toujours minimalement un résumé en français.
Dans certains cas, une maîtrise ou un doctorat consiste à publier (en anglais) des articles dans une revue scientifique. Leurs signataires font alors l’effort de rédiger des introductions et des conclusions générales en français.
C’est ce qu’on retrouve, par exemple, dans ce mémoire réalisé à l’Université Laval. L’introduction est quand même costaude avec ses 44 pages. La conclusion fait pour sa part 16 pages. Toutes les deux sont écrites en français. Mais les quatre articles qui composent l’essentiel du mémoire sont rédigés en anglais et font 114 pages. La langue qui a été attribuée à ce document est donc l’anglais. Mais en réalité, il faudrait pouvoir indiquer que son contenu est en anglais à 65 % et en français à 35 %.
Les métadonnées associées aux mémoires et thèses ne permettent pas de préciser dans quelle proportion une langue est utilisée dans un document. Les normes qui définissent ces métadonnées, comme Dublin Core par exemple, disent que plusieurs langues peuvent être attribuées à un même document. Mais il faudrait les peaufiner pour pouvoir ajouter la proportion de chacune. On aurait alors un portrait sans doute plus fin, et peut-être moins dramatique, de la part du français dans les études supérieures.
Il n’en demeure pas moins que le tableau de la place du français demeure sombre dans toutes les activités scientifiques au Canada et au Québec. Le chercheur Vincent Larivière observait déjà qu’en 2015, les travaux publiés par les chercheurs québécois et indexés dans le Web of Science étaient en anglais dans une proportion de près de 100 % en sciences naturelles et en génie, de 95 % en sciences humaines et sociales, et d’environ 67 % dans les arts et les humanités.
Plus récemment Radio-Canada a démontré que 95 % des recherches financées au Canada entre 2019 et 2022 l’ont été après une demande rédigée en anglais. Les données présentées viennent compléter le portrait en se penchant sur la langue utilisée par les scientifiques en herbe que sont les étudiantes et étudiants à la maîtrise et au doctorat.
Il semble ainsi qu’à toutes les étapes, des études aux cycles supérieurs jusqu’à la publication dans les revues savantes, en passant par le financement de la recherche, la science au Québec doit se faire en anglais pour être reconnue.
Bien sûr, l’anglicisation de la science est un phénomène mondial. Il touche des puissances en recherche comme l’Allemagne, la France, le Japon ou la Chine. Mais la science n’est-elle pas également, au même titre que la littérature, la musique ou le cinéma, le reflet d’une culture ?