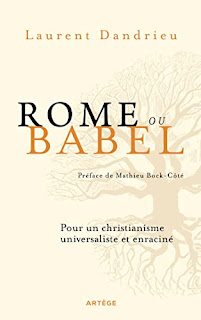Carnet voué à la promotion d'une véritable liberté scolaire au Québec, pour une diversité de programmes, pour une plus grande concurrence dans l'enseignement.
dimanche 14 mai 2023
Le danger d'une morale hypertrophiée (selon Arnold Gehlen)
samedi 13 mai 2023
Rome ou Babel : pour un christianisme universel et enraciné
Selon M. Dandrieu, la crise des migrants de 2015 a révélé une profonde fracture parmi les catholiques. Face à une « crise humanitaire mondiale », de nombreux catholiques européens n’arrivaient pas à croire qu’au début du XXIe siècle, il était encore acceptable d’invoquer l’intérêt national ou de parler de la civilisation européenne. Le pontificat de François a mis en lumière cette division qui traverse l’Église romaine : entre ceux qui la considèrent comme le vecteur d’une certaine forme de mondialisme et ceux qui restent attachés à un universalisme enraciné.
Le pape a fait de la question de l’immigration un noyau moral du catholicisme. Si ses encycliques contiennent une certaine ambiguïté, ses déclarations et ses gestes dans les médias ne laissent planer aucun doute sur sa position. Dandrieu rappelle comment François a comparé les camps de réfugiés à des « camps de concentration » lors de son homélie du 22 avril 2017, ou comment il a soutenu à l’occasion de ses rencontres du 17 février 2017 avec des étudiants à Rome que « l’Europe s’est faite à partir d’invasions, de migrants. »
Rome ou Babel démontre non seulement la centralité du thème de l’immigration dans les enseignements de François, mais attire également l’attention sur une nouveauté fondamentale du pontificat : la théologie de la migration. Dans ses conversations avec le sociologue français Dominique Wolton, qui constituent le livre Politique et société, François a déclaré que « notre théologie est une théologie des migrants ». La figure rédemptrice étant le migrant, cette nouvelle théologie cesse d’être christocentrique pour devenir « migrantocentrique ».
Le pape François, note M. Dandrieu, semble vouloir rompre le lien entre le catholicisme et la civilisation européenne. Dans un discours au Parlement européen en 2014, il a qualifié l’Europe de « grand-mère » qui, n’étant plus capable de se renouveler, devrait accepter d’être régénérée par des populations venues d’autres continents. Dans le même temps, le chef de l’Église catholique se garde bien d’évoquer les « racines chrétiennes » de l’Europe. Dans une interview accordée au quotidien catholique La Croix, il avoue éviter cette expression dont le ton peut être « vengeur » ou « triomphaliste » et donc « colonialiste ».
L’auteur de Rome ou Babel souligne à juste titre l’absurdité des accusations de colonialisme portées contre les Européens lorsqu’ils évoquent les sources chrétiennes de leur propre civilisation. L’Argentin fait ici preuve de ce que le démographe Eric Kauffmann a appelé le « multiculturalisme asymétrique ». Selon François, il y a des cultures qui ont le droit de se soucier de leur identité — les cultures des migrants qui viennent en Europe — et d’autres, comme les Européens, dont le souci de leur propre identité est un péché.
Dandrieu montre que ce tournant immigrationniste n’a pas commencé avec François. L’examen de la question exclusivement du point de vue des migrants, sans tenir compte des sociétés qui les accueillent, est déjà visible dans la constitution apostolique de Pie XII, Exsul Familia. La question de savoir comment l’ampleur de la migration ou l’origine culturelle des nouveaux arrivants affecte les sociétés d’accueil n’y est pas abordée.
Le virage mondialiste du catholicisme s’amorce véritablement dans les années 1960. Jean XXIII voit dans l’immigration de masse le signe d’une ère nouvelle et, dans son encyclique Pacem in terris, affirme que l’évolution actuelle du monde nécessite des institutions mondiales pour gouverner le monde. Bien qu’il ait développé sa propre théologie des nations, Jean-Paul II a également considéré les migrations de masse comme un processus qui, comme il l’a proclamé à l’occasion de la Journée mondiale des migrants en 1987, créerait « un monde nouveau… fondé sur la vérité et la justice ».
Feu Benoît XVI a défendu les racines européennes du catholicisme, mais l’a également associé à un certain messianisme, comme lors de la Journée mondiale des migrants en 2011, lorsqu’il a affirmé que la migration était « la préfiguration d’une Cité de Dieu indivise ». Dans son encyclique Caritas in veritate, comme nous le rappelle M. Dandrieu, il a exprimé l’un des principes fondamentaux du mondialisme : la croyance en la nécessité d’institutions mondiales qui s’occuperaient du bien commun de toute l’humanité et mettraient en œuvre son unité.
Dandrieu soutient que le catholicisme succombe à la tentation de Babel contre laquelle Benoît XVI — dont le message était plus multiforme que le messianisme mondialiste de François — avait mis en garde. L’auteur illustre ce « babélisme » par les propos de William T. Cavanaugh, théologien catholique américain. Dans une interview au magazine La Vie, à la question de savoir si le nationalisme et le catholicisme pouvaient être réconciliés, l’Américain a répondu que « catholique » signifie universel, et l’Église catholique est la première organisation véritablement mondiale, de sorte que toute segmentation est une violation infligée à la nature catholique de l’Église ».
Cette « segmentation » était pourtant incontestée par Léon XIII, qui affirmait dans Sapientiae Christianae que nous devions une fidélité et un amour particuliers à la patrie dans laquelle nous sommes nés. Pie X n’a pas hésité à le dire plus crûment : « Si le catholicisme était ennemi de la patrie, il ne serait pas une religion divine. » À l’unité mondialiste de la Tour de Babel, affirme Dandrieu, il faut opposer l’universalisme enraciné du catholicisme : l’unité spirituelle des nations ancrées dans leurs cultures.
Cherchant les sources de cette « contamination » du véritable universalisme catholique par le mondialisme, Dandrieu pointe du doigt le personnalisme. Ce courant intellectuel a détaché le catholicisme de la notion de bien commun pour le recentrer sur l’individu. Si les idées de Jacques Maritain et de ses disciples visaient à critiquer le libéralisme, elles ont involontairement conduit à son triomphe au sein de l’Église. Dans une veine personnaliste, Jean XXIII a défini le bien commun comme « la sauvegarde des droits et des devoirs de la personne humaine », négligeant ainsi sa dimension intrinsèquement communautaire, centrale dans la pensée de saint Thomas et dans toute la tradition catholique classique. Sans ancrage dans le bien commun, le personnalisme a dégénéré en subjectivisme, fournissant les conditions intellectuelles et morales de l’utopie d’une humanité unie.
Je reste d’avis qu’après 1945, l’Église catholique a commencé à dériver vers le romantisme politique. Selon Carl Schmitt, ce dernier se résume à l’abolition du monde concret au nom d’une réalité imaginée : « Leur fonction romantique est la négation de l’ici et du maintenant ». Pierre Lasserre, autre critique du romantisme, soutient que ce que les romantiques recherchent en politique, c’est avant tout une « ivresse » morale. Dandrieu, pour sa part, écrit que le mondialisme catholique « tourne le dos à la réalité… rompt avec le monde concret et les communautés naturelles, remplaçant le rapport concret au monde par un rapport purement idéologique et abstrait ».
L’attitude de l’Église catholique à l’égard de l’immigration, en particulier sous le pontificat de François, semble purement romantique. Elle ne tient compte ni des limites réelles des États ni des communautés nationales appelées à absorber tous les « malheureux de la terre ». Elle procure une « ivresse » morale aux fidèles et à la hiérarchie, nie les contraintes du « ici et maintenant » et représente, par essence, une rupture dans la tradition de la doctrine catholique, sapant l’un des droits les plus cruciaux auxquels les nations peuvent prétendre, le droit à la continuité.
L’essayiste français préconise un retour au réalisme de Saint Thomas. Si le grand philosophe ne peut pas nous dire quelles institutions politiques nous devrions construire, explique-t-il, il nous permet de voir à travers les aberrations des idéaux politiques contemporains. Il faut convenir qu’un virage radical vers le réalisme est une tâche urgente pour l’Église catholique. Il servirait d’antidote à ce qui est le plus pernicieux dans sa situation romantique actuelle : le mépris des problèmes concrets et le recours aux émotions lorsqu’il s’agit de questions de la plus haute importance.
Il est grand temps de redonner au catholicisme sa forme authentique : romain et non romantique. Rome ou Babel ouvre la voie à cette restauration.
Texte de Krzysztof Tyszka-Drozdowski, écrivain et analyste dans l’une des agences gouvernementales polonaises chargées de la politique industrielle.
Rome ou Babel
Pour un christianisme universaliste et enraciné
par Laurent Dandrieu
préface de Mathieu Bock-Côté (Préface)
aux éditions Artège
à Perpignan
Date de parution : 14/IX/2022
400 pp.
EAN : 9 791 033 612 971
Voir aussi
Le danger d'une morale hypertrophiée (selon Arnold Gehlen)
« C'était un délire d'une génération de féministes » : ces femmes qui regrettent de ne pas être mère
Les années passant, des femmes vivent amèrement leur choix de ne pas avoir eu d’enfant. Écartelées entre une volonté d’indépendance et un désir de maternité, elles posent un regard critique sur leur décision.
Quand elle était petite, Julie [prénom modifié] adorait les bébés. Née d’une mère féministe et d’un père qui a pris la poudre d’escampette, la fillette passe des heures à coudre des vêtements pour enfants. « J’ai toujours su que je voulais être mère », confie-t-elle. Mais à 20 ans, elle rêvait d’émancipation, et entra dans un mouvement féministe « égalitariste ». Cheveux courts peints en bleu, Julie se forma à « déconstruire le couple, et à tout faire comme les hommes. On était assez misogynes. »
Que pensait-on des nourrissons dans le milieu ? « Avoir un enfant était associé à la soumission de la femme à son mari, explique cette graphiste de 31 ans, qui a hésité à se faire ligaturer les trompes. Tout était fait pour désacraliser la maternité. » La jeune fille enfouit son désir d’enfant. Quand elle a vingt-trois ans, Julie tombe enceinte. Elle subit un avortement : « J’ai mis beaucoup de temps à m’en remettre. Personne ne m’avait dit que ça allait être si dur. Surtout qu’au fond de moi, je pense que je le voulais ce bébé. Mais on me disait que ce n’était qu’un amas de cellules. »
Aujourd’hui, Julie a quitté ce groupe féministe et ne partage plus grand-chose avec ses adeptes. Sa longue chevelure encadrant son visage poupon et ses jupes fleuries en témoignent. La jeune femme, célibataire après une relation de six ans avec un homme, voit passer les années avec une pointe d’angoisse. « Quand je me suis retrouvée seule à 29 ans, j’ai paniqué en me disant qu’il fallait tout recommencer. On m’a fait croire que j’avais le temps, que ma jeunesse était infinie », regrette-t-elle.
Les enfants, pour Louise, qui a fêté ses 63 printemps en avril dernier, ça n’a jamais été son truc. Non qu’elle ne les aime pas, au contraire. Elle n’était simplement pas faite pour ça. Mais après la mort de sa mère, le regret se fait ressentir. « J’ai pensé à la relation merveilleuse que j’avais eue avec elle, j’étais sa fille unique, confie-t-elle depuis Berthier-sur-Mer, petite bourgade du Québec. Je l’ai aimée tendrement. Depuis qu’elle n’est plus là, je me dis que je suis sans doute passée à côté de quelque chose de très beau en n’ayant pas d’enfant. »
Grande amoureuse des animaux, cette végétarienne qui a travaillé au service de personnes handicapées pendant 35 ans, aurait aimé apprendre à sa descendance « des valeurs de respect et de compassion envers le vivant ». « Quand je vois des jeunes qui ont des enfants, je les trouve chanceux de pouvoir leur transmettre des choses dès leur enfance. »
Le regret de ne pas laisser quelque chose après elles est ce qui est le plus prégnant chez ces femmes qui n’ont pas donné la vie. « C’est même la cause principale », abonde Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste, auteur de nombreux ouvrages sur le couple et la famille. L’analyste reçoit dans son cabinet un grand nombre de femmes autour de la quarantaine, confrontées au regret de ne pas avoir d’enfant. « Ces femmes arrivent au bout d’un entonnoir, et vivent cela avec beaucoup de souffrances, relève-t-il. Très profondément, il y a dans la maternité cette idée que la vie prend un sens différent à partir du moment où l’on se décentre de soi-même. »
Jeunes filles de 40 ans
La majorité des femmes nullipares qui viennent le consulter ont vaguement pensé à la maternité, mais n’en ont jamais fait une priorité. Elles ont attendu le bon moment, le bon père, le bon partenaire, ce qui ne s’est pas fait. Et il y a celles, moins nombreuses, qui ont refusé la maternité parce qu’elles se trouvaient très heureuses sans enfant. Jusqu’à 38 ans, elles se sont senties jeunes filles, dans une quête de plaisirs et de découvertes. Mais parallèlement, leur cycle s’est essoufflé. Quand elles comprennent que la ménopause approche, c’est paradoxalement à ce moment qu’elles veulent créer une famille. « Elles ont oublié leur horloge biologique », explique Serge Hefez. Car la fertilité féminine est optimale entre 18 et 31 ans, d’après l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). À partir de cet âge-là, le taux de fertilité commence à diminuer, et encore plus à 35 ans. Au-delà, l’insuffisance ovarienne est la première cause d’infertilité pour les femmes.
Si elles repoussent de plus en plus le moment d’avoir des enfants (en 2022, les femmes françaises avaient en moyenne leur premier enfant à l’âge de 31 ans, contre 26,5 ans en 1977 selon l’Insee), c’est parce que la place de l’individu contemporain dans la société a radicalement changé. [Au Québec, l'âge moyen de la mère au premier enfant était de 30,98 ans en 2021. Voir ci-contre] « Jusque dans les années 50, le destin d’un homme ou d’une femme était d’appartenir à un groupe ou à une caste, estime Serge Hefez. L’adhésion à une famille signait l’appartenance dans une société. » Avec l’égalité progressive des sexes, les femmes ont acquis leur individualité, mais le paient parfois cher : « Toutes les patientes quadragénaires que je rencontre essaient de négocier leur indépendance et leur désir de maternité. Elles comprennent que leur émancipation peut se retourner contre elles-mêmes. »
Sacrifices et responsabilités
Pour Marie-Estelle Dupont, psychologue, psychothérapeute, auteur de Réussir son divorce (Larousse, 2023) et L’Anti-mère (Albin Michel, 2022), le regard que pose la société sur la maternité est révélateur : « Qu’est-ce qu’on véhicule auprès de nos jeunes comme image du couple, de la famille et de la liberté ? On ne cesse de leur dire qu’ils vont connaître des crises à répétition, on ne leur transmet que des messages de désespoir. Ils entendent à longueur de journée “si tu fais un bébé, tu tues un arbre”. Je peux comprendre qu’ils ne veulent plus donner la vie. »
Il suffit de voir la médiatisation récente autour de très jeunes femmes qui se font ligaturer les trompes. Ou d’éplucher les innombrables témoignages sur les réseaux sociaux de femmes qui affirment leur refus d’avoir des enfants… ou qui regrettent d’en avoir. Car donner la vie fait redevenir la mère dépendante et vulnérable, cela réveille son propre rapport à sa dépendance. Pour autant, « on n’explique pas assez qu’un enfant est une coopération entre deux adultes qui s’aiment, que c’est le fruit d’une complémentarité, poursuit la psychologue. Donc quand on leur transmet des messages très négatifs sur les sexes et l’avenir de la planète, c’est normal que des femmes aient du mal à se projeter là-dedans. »
La plupart d’entre elles posent un regard ambivalent sur la possibilité qu’elles ont de s’accomplir autrement que par la famille. Aline*, une de ses patientes sans enfant, lui a un jour affirmé : « Je me suis fait avoir par la société, qui m’a dit que pour être libre, je devais avoir une carrière ». Sandra*, une autre femme qui s’est consacrée à son travail toute sa vie, lui a confié : « Je comprends que j’ai une vie qui n’a aucun sens. On m’a vendu que la réussite, c’était d’avoir un job, mais c’était un délire d’une génération de féministes wonder woman des années 90. »
L’ex-féministe Julie abonde : « La société a essayé d’édulcorer la maternité, comme on édulcore la mort. On la cache car devenir mère implique des sacrifices et de grandes responsabilités, de la souffrance aussi. Les femmes l’ont oublié. »
Ne pas avoir exploré ce lien de filiation et ce qu’il implique de tendresse, de souvenirs et de mémoire peut être très douloureux : « C’est une partie d’elles qu’elles ont l’impression de ne pas connaître, décrypte Marie-Estelle Dupont. Le fait de devenir parent est un changement identitaire, c’est très particulier et mystérieux. Souvent, la non-maternité réveille chez les femmes une angoisse de mort, le vieillissement est doublement vertigineux, car il n’y a pas la consolation de continuation après soi. »
Le féminisme a jeté la mère à la trappe
Selon Marie-Estelle Dupont, « on a jeté la mère à la trappe dans cette histoire de féminisme. On a fait la femme mais la mère a disparu. Une société juste pourrait permettre à la femme de choisir de travailler dans le monde extérieur ou travailler à éduquer ses jeunes enfants. » De moins en moins de femmes choisissent de rester chez elles pour élever leurs enfants. En 2014, elles n’étaient plus que 22 % à souscrire au modèle de la mère au foyer, contre 43 % en 2002 (l’Insee).
Pourtant, « c’est un travail d’élever sa progéniture, martèle la psychologue. On pourrait rémunérer les femmes qui éduquent leurs enfants. » La présence du père après l’accouchement, permettant à la mère d’être épaulée et de reprendre le travail plus sereinement, joue également un rôle dans le choix d’avoir un enfant. En 2021, le congé paternité est passé à 28 jours, contre 14 auparavant. Mais pour 54 % des 25-34 ans, c’est encore insuffisant, selon le 2e baromètre OpinionWay pour Familles Durables (2023).
Pour contourner les limites de la nature, certaines femmes se tournent vers la PMA, avec ou sans père. Elles s’emparent alors d’une avancée de la science, « qui les rend heureuses, mais qui en même temps les fatigue, car elles élèvent leur enfant seules. La multiplication des choix de la femme est exaltante, mais peut être épuisante », estime Serge Hefez.
vendredi 12 mai 2023
« Et si les femmes ne devaient rien au féminisme ? »
« Je préfère les femmes qui jettent des sorts aux hommes qui construisent des EPR » : on se souvient de cette phrase de l’inénarrable Sandrine Rousseau. Loin d’être une simple boutade, cette sortie résume à merveille la vulgate d’une certaine gauche féministe et écologiste qui voudrait réunir, sous le visage unique de l’ennemi, le capitalisme, le productivisme et le patriarcat. Ce que la députée de la Nupes appelle l’« androcène », qu’elle invite à « congédier » pour atteindre enfin l’égalité totale entre hommes et femmes.
Dans un livre puissant et passionnant, Féminicène (Fayard), Véra Nikolski, normalienne et docteur en science politique, balaie magistralement cette thèse.
Qu’est-ce que le « féminicène » ? C’est l’ère dans laquelle nous vivons, celle où l’égalité entre hommes et femmes a atteint un comble historique. Et ce n’est pas un hasard si ce summum d’égalité est atteint au moment même où la dégradation de l’environnement et l’épuisement des ressources naturelles atteignent leur apogée : il y a un lien entre le productivisme technicien — ce qu’on appelle désormais « anthropocène » — et l’émancipation des femmes, qui n’est pas un lien d’antagonisme, mais de corrélation. Pour le comprendre, il faut se plonger dans l’origine du patriarcat et les causes réelles de l’émancipation féminine.
La propagande néoféministe ne cesse de le marteler : ce serait grâce aux « luttes » des féministes que les femmes auraient conquis leurs droits. Mais qu’est-ce qu’une victoire obtenue sans barricades, sans grève, sans violence, qui parvient à renverser en soixante-dix ans un système vieux de 100 000 ans ? La libération n’a pas été arrachée, mais accordée, tombée comme un fruit mûr de l’arbre pourrissant d’un patriarcat privé de ses fondements. Les néoféministes sont embarrassées par l’origine biologique du patriarcat. Elles évacuent en général le problème en postulant une construction sociale de la domination masculine depuis l’aube de l’humanité. C’est bien sûr faux : l’invariant anthropologique de la domination masculine n’a pas pour fondements des facteurs sociaux ou idéologiques, mais des contraintes matérielles et physiques. Dans un environnement hostile, où la priorité est l’impératif de survie, le dimorphisme sexuel (le fait que la femme engendre dans son propre corps et l’homme engendre dans le corps d’autrui) produit des avantages comparatifs (la femme enceinte et allaitante pouvant moins se déplacer, la chasse devient une prérogative masculine) et donc une division sexuelle du travail qui se sédimente culturellement. C’est pourquoi le vrai point de bascule pour l’émancipation féminine n’est pas la bataille des suffragettes du début du XXe siècle, mais l’invention de la machine à vapeur en 1784. « L’émancipation des femmes est l’enfant de la révolution industrielle. »
Nikolski est un peu la Jancovici du féminisme. Tout comme l’ingénieur devenu iconique nous rappelle combien le progrès technique nous est devenu familier au point que nous oublions ses conditions d’existence (une énergie abondante et bon marché), Nikolski nous rappelle les soubassements technologiques de l’émancipation féminine. La mécanisation, qui dévalue la force physique et l’avantage comparatif masculin, l’allégement du travail domestique par la machine (lessive, confection des vêtements, vaisselle), le progrès médical qui fait chuter drastiquement la mortalité infantile et celle des femmes en couches : voilà ce qui a rendu l’émancipation des femmes possible. Ce ne sont pas les sorcières et les féministes qui ont libéré les femmes, mais le pétrole, les antibiotiques et l’aspirateur. Les femmes devraient élever des statues à Pasteur plutôt qu’à Olympe de Gouges.
La démonstration est convaincante. Le livre de Véra Nikolski, avec sa perspective matérialiste, dit l’inverse de celui de Patrick Buisson, Décadanse, que nous avions chroniqué ici même : non, ce ne sont pas les idées qui gouvernement le monde, c’est la superstructure économique et technique qui fait basculer les comportements. Ainsi, rappelle Nikolski, la pilule et l’avortement, réclamations féministes, ne viennent que couronner un processus : la maîtrise des naissances n’avait aucun sens dans un monde où la mortalité infantile atteignait 45 % (1820). Est-ce la science ou l’idéologie qui mène le monde ? La vérité doit être à mi-chemin entre les deux, car, sinon, comment expliquer que l’Occident chrétien ait été le terreau le plus fertile de l’émancipation féminine ? Le Japon qui cumule patriarcat et développement industriel est un contre-exemple, ainsi que les pays du Golfe où la religion est venue freiner le développement des femmes.
Le livre de Véra Nikolski devient crucial lorsqu’il se projette dans l’avenir. Si l’émancipation féminine est due à la civilisation thermo-industrielle, reposant sur des sources d’énergie abondantes et peu chères, que va-t-il se passer lorsque celle-ci va disparaître ? On peut discuter à l’infini des scénarios effondristes adoptés par l’auteur, reste qu’on ne peut contester que le XXIe siècle sera pour l’Occident plus pauvre, plus chaotique et plus violent que les 70 dernières années. Or, « en ignorant la fragilité des conditions sur lesquelles repose leur émancipation, les féministes ne se donnent pas les moyens de les préserver ».

La « philosophe féministe et prof de science politique » Camille Froidevaux-Metterie n'a pas aimé la thèse de Véra Nikolski. Eugénie Bastié lui rappelle ce qu'en pensait Simone de Beauvoir.
Dans Ravage, la dystopie de Barjavel où la civilisation s’effondre faute d’électricité, la polygamie est de retour et les femmes sont vouées à la procréation. C’est le sort qui nous guette dans un scénario de décroissance, avertit Nikolski. Ce ne sont pas les arrêts de la Cour suprême américaine qui occasionneront le « ressac » historique, mais la pénurie de médicaments et le retour de la mortalité infantile. Vouloir la décroissance et l’émancipation féminine, c’est vouloir le beurre et l’argent du beurre. Parce que nous n’échapperons sans doute pas à la première (la fin de l’abondance est déjà en route), il faut nous préparer à la seconde. C’est pourquoi Nikolksi plaide pour un « féminisme de faire », à rebours du féminisme de la plainte d’aujourd’hui. « Ne vaut-il pas mieux armer les femmes plutôt que de les protéger ? », se demande l’auteur, elle-même pratiquante des arts martiaux.
Ce livre brillant, subtil et salutaire est à mettre entre les mains de toutes les jeunes filles, plutôt que des manuels d’écriture inclusive. Il dit aux femmes : arrêtez de vous plaindre, battez-vous, investissez les filières scientifiques, ne réclamez pas, prenez et créez vos places. Suivez les pas de Marie Curie, George Sand ou Madeleine Brès (première femme médecin) plutôt que ceux de Caroline De Haas, Sandrine Rousseau et Adèle Haenel. Moins de sorcières, plus de femmes ingénieurs nucléaires !
Féminicène
par Véra Nikolski,
paru chez Fayard,
à Paris,
le 3 mai 2023,
380 pp,
ISBN-10 : 2 213 726 051
ISBN-13 : 978-2213726052
Voir aussi
Recension de Economic Facts and Fallacies de Thomas Sowell
jeudi 11 mai 2023
France — C’est l’excellence qu’on assassine
Jusqu’alors, les deux plus prestigieux lycées publics parisiens sélectionnaient leurs futurs éléments au terme d’un examen approfondi du dossier. Mais voilà que, en janvier 2022, sans l’avis des conseils d’administration des établissements concernés, le rectorat de Paris annonce l’intégration de Louis-le-Grand et Henri-IV dans le système d’affectation Affelnet et la fin de la sélection.
Contrairement au reste de l’enseignement secondaire public, en effet, ces deux lycées n’étaient pas soumis à cet algorithme de répartition des élèves de seconde. Une exception perçue comme une injustice et une rupture d’égalité par les promoteurs de cet outil censé renforcer la mixité sociale dans les lycées.
Dès l’annonce du projet, de nombreuses voix s’étaient élevées pour dénoncer une atteinte au modèle républicain de l’excellence. En face, on affirmait que l’enjeu était de permettre « au jeune Péguy, au jeune Camus d’aujourd’hui de bénéficier de l’excellence », selon le mot du recteur de l’académie de Paris, Christophe Kerrero ; une lecture a contrario de ces propos suggérant que Louis-le-Grand et Henri-IV ne le permettaient pas avant la réforme.
Ce qui est parfaitement inexact selon Alexandre Barrat, conseiller d’arrondissement dans le Ve arrondissement, membre du conseil d’administration du lycée Louis-le-Grand et ancien élève. Il déplore un procès en élitisme qui ne correspond pas à la réalité : « Ces dernières années, presque 40 % des élèves de Louis-le-Grand étaient originaires de banlieue. Quant au nombre de boursiers, il oscillait entre 10 et 15 % selon les années. » Voudrait-on faire mieux, l’étude « à la main » des dossiers de candidature permettrait aisément de réaliser cet objectif, soutient-il.
Tombeau pour l’excellence
Conseillère de Paris (groupe Changer Paris), membre du conseil d’administration du collège et du lycée Henri-IV, Anne Biraben abonde dans ce sens : « Si l’on souhaite diversifier le recrutement, nous n’avons qu’à puiser dans le vivier de talents issus de milieux modestes, tout en conservant le principe de la sélection. » L’ancien ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, lui, a préféré un logiciel censé garantir un niveau d’excellence identique, du moins en théorie. En pratique, c’est moins évident.
Entrons dans le détail : cette procédure assumant une logique de discrimination positive repose principalement sur deux critères. Le premier est l’indice de position sociale (IPS). Élaboré par le ministère de l’Éducation nationale en 2016, cet indicateur permet en théorie d’appréhender le capital social, économique et culturel des élèves d’un collège donné. Il est construit à partir des professions des parents renseignées sur des formulaires à chaque rentrée de sixième. Les valeurs possibles s’étendent de 38 à 179. Plus cet indice est élevé, plus l’environnement familial de l’élève est favorable à sa réussite scolaire.
Si l’indice du collège est inférieur à la moyenne académique (124), l’élève bénéficiera d’un bonus de 600 à 1 200 points. A contrario, si l’établissement est jugé privilégié, le score IPS sera de zéro. « Vous voyez l’absurdité du système : aujourd’hui, un collégien à Henri-IV n’a quasi aucune chance d’entrer au lycée Henri-IV. Idem pour les enfants de famille modeste qui auraient le malheur d’habiter dans un quartier privilégié », déplore Anne Biraben.
À la fin, c’est le privé qui gagne
Le deuxième critère, tout aussi problématique, est celui de la notation. De fait, cette procédure informatisée n’a pas la sensibilité pour détecter les très bons dossiers et les profils singuliers. Affelnet attribue ainsi le même nombre de points à tous les élèves ayant entre 15 et 20 de moyenne générale. Ce que le rectorat de Paris appelle pudiquement « lissage », tandis que les opposants à l’algorithme parlent de « nivellement par le bas ».
« Comment appelez-vous un système où l’on rabaisse le niveau d’exigence au nom de la démocratisation de l’éducation ? », fait mine d’interroger une professeur d’Henri-IV. A-t-elle constaté une baisse spectaculaire du niveau en seconde ? « Spectaculaire, non, significative, oui. »Autre nouveauté déplaisante : « Pour la première fois, j’ai compris ce que signifiait “tenir une classe”. Rien de bien méchant, mais tout de même, je n’imaginais pas que la discipline serait un sujet à Henri-IV. »
Une baisse du niveau et des lycéens plus agités, c’est également le constat d’une professeur à Louis-le-Grand. « Il y a encore de très bons élèves, et c’est heureux. Ce qui est nouveau, ce sont les élèves moyens ou très faibles. » Ajoutez à cela la présence d’élèves « mal élevés » avec lesquels il faut faire de la discipline et le cours n’est plus le même : « Je vais plus lentement, donc je transmets moins. »
Et de prédire à l’horizon de deux ou trois ans une fuite généralisée vers l’enseignement privé. Tous nos interlocuteurs sans exception l’affirment : le privé est le grand gagnant de cette réforme. Ce n’est peut-être pas une coïncidence si le célèbre institut privé hors contrat Ipesup — situé à un jet de pierres du lycée Henri-IV — a ouvert deux classes de seconde à la rentrée 2022. Alors, adieu les filières d’excellence dans le public ? « Très certainement, mais que les lycées privés ne se méprennent pas, prévient notre enseignante d’Henri-IV, c’est l’affaire de quelques années avant qu’ils ne soient mis au pas ».
Pays-Bas — Plus les non-Occidentaux y vivent depuis longtemps, plus leur confiance envers autrui diminue
Une étude précédente (Schmeets et Exel, 2021) avait déjà montré que les personnes issues de l’immigration font moins confiance à leurs semblables, mais ont souvent plus confiance aux institutions. La théorie des attentes et de l’assimilation a permis de déterminer si la durée du séjour jouait un rôle à cet égard. Selon ces perspectives, les immigrants ont de grandes attentes à leur arrivée quant au niveau de confiance du pays où ils immigrent, mais plus ils y restent longtemps, plus ils ajustent leur position sur l’échelle de confiance. Et cela s’applique plus fortement aux immigrants venant de pays, pour la plupart non occidentaux, dont les indicateurs de démocratie sont faibles.
Cette étude a montré que la théorie des attentes ne s’applique pas à la confiance dans autrui. Les immigrants n’ont pas plus, mais plutôt moins confiance dans les autres personnes que le groupe d’origine néerlandaise. Du point de vue de l’assimilation, on s’attend à ce qu’ils deviennent plus proches du groupe néerlandais au fur et à mesure qu’ils restent aux Pays-Bas. Là encore, cela ne correspond pas aux résultats.
La confiance sociale, chez les immigrés qui restent plus longtemps aux Pays-Bas, n’augmente que légèrement pour le groupe occidental, alors qu’elle diminue en fait pour le groupe non occidental. Ainsi, alors que la distance de confiance sociale par rapport au groupe néerlandais diminue pour le groupe occidental, elle augmente pour le groupe non occidental.
Les deux perspectives théoriques semblent s’appliquer davantage à la confiance dans les institutions : les immigrants, en particulier, ont une plus grande confiance fiduciaire dans les institutions au cours de la première période de vie aux Pays-Bas que le groupe d’origine néerlandaise. Il semble également que cette confiance diminue au fur et à mesure que les immigrés restent aux Pays-Bas. Là encore, la distinction entre Occidentaux et non-Occidentaux est importante.
Pour l’immigré non occidental, dans presque tous les aspects de la confiance, celle-ci diminue au fur et à mesure qu’il vit aux Pays-Bas. Ce n’est pas le cas pour le groupe occidental. Soit il n’y a pas d’effet de la durée du séjour (police, médias, chambre basse, banques, églises), soit la corrélation est positive : un séjour plus long est associé à une plus grande confiance (armée, juges, UE, grandes entreprises). Ces résultats sont cohérents avec les études de Röder et Mühlau (2011, pp. 382-383 ; 2012, p. 12) et d’Adman et Strömblad (2015, p. 112) qui constatent une plus grande confiance [initiale] dans la police et dans les juges, en particulier chez les immigrés venant de pays où le niveau de corruption est élevé, confiance qui diminue toutefois plus ils restent longtemps dans le pays.
[Idéalisation initiale des institutions de la part des non-Occidentaux ?]
Ainsi, au moins en ce qui concerne la confiance institutionnelle, les résultats soutiennent à la fois la théorie des attentes et la théorie de l’assimilation. Mais cela ne s’applique qu’au groupe non occidental. Cette convergence des immigrants vers le groupe néerlandais indique l’assimilation et entraîne l’intégration. Étant donné que cette évolution diffère entre le groupe occidental et le groupe non occidental, il s’agit d’une assimilation segmentée (Portes, Fernandez-Kelly et Haller, 2005). Les mécanismes qui jouent un rôle à cet égard n’ont pas été démontrés dans cet article. Du point de vue de la théorie de l’expectative, les attentes élevées à l’égard des institutions s’adaptent à une durée de résidence plus longue. Mais il est également concevable que la discrimination joue un rôle (supplémentaire) : plus les immigrés vivent longtemps aux Pays-Bas, plus ils sont [seraient ?] victimes de discrimination, ce qui entraîne une diminution de la confiance dans les institutions.
Voir aussi
Vaste étude confirme que la diversité ethnique a des effets négatifs sur la cohésion sociale
Et si la diversité diminuait la confiance ?
Étude — Baisse de « solidarité » corrélée à l’augmentation du nombre d’étrangers
Un Québec de plus en plus divers, est-ce vraiment une bonne chose ?
mercredi 10 mai 2023
Histoire — Inondations de mars 1936 à Baie-Saint-Paul
 |
| Le quartier Saint-Joseph à Baie-Saint-Paul a été durement touché par les inondations… |
 |
Photo parue à la une du journal La Patrie du jeudi 26 mars 1936 avec cette légende : « le grand mur de protection de la Baie-Saint-Paul, submergé par les eaux de la rivière du Gouffre. » |
 |
| Photo parue à la une du journal La Patrie du jeudi 26 mars 1936 avec cette légende : « M. l'abbé J.-C. Tremblay, curé de Baie-Saint-Paul, photographié dans une des rues inondées de sa paroisse. » |
Voir aussi
De plus en plus d’inondations à cause des « changements climatiques », vraiment ?
mardi 9 mai 2023
Vaste étude confirme que la diversité ethnique a des effets négatifs sur la cohésion sociale
Conformément à la majorité des études précédentes, nous constatons que la diversité ethnique statistique a des effets négatifs sur chacune de nos cinq mesures de la cohésion sociale de quartier :
- la confiance,
- l’efficacité collective,
- l’interconnexion,
- les problèmes sociaux signalés et
- la satisfaction générale à l’égard de la vie de quartier.
L’Observatoire de l’immigration et de la démographie résume ainsi l’article :
Liens connexes
Et si la diversité diminuait la confiance ?
Étude — Baisse de « solidarité » corrélée à l’augmentation du nombre d’étrangers
Un Québec de plus en plus divers, est-ce vraiment une bonne chose ?
Malgré une immigration record : stagnation, voire baisse, du PIB/habitant au Canada en 2022 (et 2023 selon les prévisions)
 |
| Aucune croissance par habitant dans le "G6" depuis 2019 (G6 [pas Japon] = tous des pays à forte immigration...), la croissance est ailleurs |
Source : Institut Fraser
Voir aussi
Les nouvelles données de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 nous ont permis d’actualiser notre estimation précédente afin de mettre en lumière le succès des récentes mesures importantes prises par le gouvernement fédéral pour améliorer la sélection des nouveaux immigrants en vue d’améliorer leurs perspectives économiques. Nous avons constaté que le transfert fiscal net annuel aux nouveaux immigrants est nettement inférieur, à 5 329 $ par habitant, aux 6 000 $ que nous avions trouvés dans notre analyse précédente. Toutefois, comme le nombre d’immigrants bénéficiant de ce transfert a considérablement augmenté, la charge fiscale totale est passée de 16 à 24 milliards de dollars en 2005, à 20 à 28 milliards de dollars en 2010, et à 27 à 35 milliards de dollars en 2014. (Institut Fraser, 2015)
Recension de « Canada maximum, vers un pays de 100 millions »
Au rythme actuel sous Trudeau et Legault : 12 millions d'habitants à Montréal et 5 à Québec en 2100
Canada — Faire passer l’immigration de 300 000 personnes par an à un million
Population du Canada : croissance record de 1 050 110 personnes enregistrée en 2022 (m à j Québec)
Débat Vincent Geloso (libéral) c. Alexandre Cormier-Denis (nationaliste/identaire) sur l'immigration
Voir aussi
Environ sept Américains sur dix (71 %) pensent que les gens ont moins confiance les uns dans les autres qu’il y a 20 ans. À titre de comparaison, 22 % pensent que les Américains ont autant confiance les uns dans les autres aujourd’hui qu’il y a une génération et 7 % pensent qu’ils ont plus confiance aujourd’hui qu’à l’époque. (Pew Research, 2019)
Les nouvelles données de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 nous ont permis d’actualiser notre estimation précédente afin de mettre en lumière le succès des récentes mesures importantes prises par le gouvernement fédéral pour améliorer la sélection des nouveaux immigrants en vue d’améliorer leurs perspectives économiques. Nous avons constaté que le transfert fiscal net annuel aux nouveaux immigrants est nettement inférieur, à 5 329 $ par habitant, aux 6 000 $ que nous avions trouvés dans notre analyse précédente. Toutefois, comme le nombre d’immigrants bénéficiant de ce transfert a considérablement augmenté, la charge fiscale totale est passée de 16 à 24 milliards de dollars en 2005, à 20 à 28 milliards de dollars en 2010, et à 27 à 35 milliards de dollars en 2014. (Institut Fraser, 2015)
Large étude confirme que la diversité ethnique a des effets négatifs sur la cohésion sociale (Ruud Koopmans & Merlin Schaeffer)
Et si la diversité diminuait la confiance ?
« Trop de diversité sape les fondements de la solidarité »
Étude — Baisse de « solidarité » corrélée à l’augmentation du nombre d’étrangers
Un Québec de plus en plus divers, est-ce vraiment une bonne chose ?
Pays-Bas — Plus les non-Occidentaux y vivent depuis longtemps, plus leur confiance envers autrui diminue (contrairement aux immigrés occidentaux, les immigrés non occidentaux de 2e génération font moins confiance envers leurs prochains que leurs parents ne le font...)